 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes ». Luis Sepulveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour
Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Nous marchions en file indienne à découvert et à flanc de colline et à chaque pas, je redoutais un peu plus que les cieux gris, pesants et lourds, poisseux et humides nous avalent comme une vulgaire bouchée, proie trop facile dans le déchaînement des forces de la nature. Des éclairs zébraient à présent l’atmosphère charbonneuse et il n’y avait en vue, nul endroit pour nous abriter. Cela semblait tonner de partout, résonnait tout autour comme si nous avions été enfermés dans une grosse caisse qu’un mauvais génie aurait frappé sans relâche et avec force. Nous aurions pu marcher des heures, à perdre haleine, sans jamais trouver un arbre, un toit, quelque porche ou abri pour nous protéger de la pluie, des bourrasques et de la foudre, pour nous sécher un peu et nous reposer du déluge qui s’abattait sur nos têtes. Rien sur l’horizon. Lisse tel le crâne d’un chauve. Désespérant et inquiétant.
Nous finîmes par nous arrêter, épuisés, las, vidés et nous nous écroulâmes tous ensemble le nez dans la terre comme des quilles balayées méchamment, abandonnant tous dans cet épuisement contagieux. Ce que nous aurions dû décider par intelligence, nous en fûmes contraint par la force. La nature reprend toujours le dessus sur l’homme et nous passâmes la nuit, trempés jusqu’à l’os, tremblant, comateux, délirant de fièvre, le corps dans la boue mais à l’abri de la foudre.
Quand le jour parut, nous fûmes saisis par la clarté du ciel : tout avait été balayé. Pas un nuage, plus de traces du combat de la veille entre les cieux et la terre. Seul stigmate : de la boue sèche sur nos habits et nos corps, de la fièvre dans nos têtes et la peur au ventre d’être passé près de l’irréparable.
-
-
Le roman, c'est une drogue
 "Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
"Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "Anna Gavalda
-
J.M.G Le Clézio prix Nobel de littérature 2008
"J'écris pour essayer de savoir qui je suis".
"Les écrivains sont fragiles. Tous les êtres humains sont fragiles, mais les écrviains sont vraiment des petites choses très fragiles qui peuvent se casser facilement... Donc tout ce qui leur donne du soutien, qui leur remonte le moral, est très bon".
J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.
-
Debout devant l'évier de la cuisine
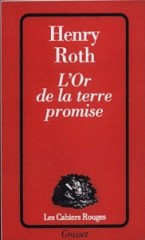 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Debout devant l’évier de la cuisine, les yeux fixés sur les robinets de cuivre qui brillaient si loin de lui et sur la goutte d’eau pendue au bout de leur nez, qui grossissait lentement, puis tombait, David prit conscience une fois de plus que ce monde avait été crée sans tenir compte de lui». Henri Roth, L’Or de la terre promise
Debout devant l’évier de la cuisine, les yeux fixés sur les robinets de cuivre qui brillaient si loin de lui et sur la goutte d’eau pendue au bout de leur nez, qui grossissait lentement, puis tombait, David prit conscience une fois de plus que ce monde avait été crée sans tenir compte de lui. Il lui était impossible d’atteindre la poignée du robinet, de la tourner même légèrement pour faire couler un peu d’eau pour remplir son verre. Il allait devoir attendre le retour de ses parents, ce soir, quand la nuit aura enveloppé de ses bras inquiétants tout le quartier et que l’horloge dans la cuisine indiquera les vingt et une heures avec ses aiguilles suiffeuses et répugnantes. Il les suivait souvent du regard pendant des heures, espérant et craignant à la fois, le retour de son père ou de sa mère.
En attendant, il lui fallait étancher sa soif. Il aurait vendu une petite auto, s’il en avait eu une, comme celles qu’il regardait avec envie dans la vitrine du marchand de jouets quand il passait sur la 7ème avenue, pour s’acheter une bouteille de Coca Cola. Il ouvrit le réfrigérateur et envia la bouteille de lait. Son père s’en apercevrait certainement. Il allait être furieux puis violent mais à vrai dire, il le cognera bien ce soir pour un oui ou pour un non alors qu’est-ce que cela changera pour lui, une rouste, c’est une rouste.
Il hésitait, tournant nerveusement avec son index une petite boucle de cheveux mordorés près de ses oreilles. Il pouvait toujours sortir mais il n’avait pas d’argent. Il y avait bien le petit pot en grès où sa mère laissait toujours quelques pièces mais s’il venait à manquer rien qu’un seul penny, sa mère ne décolérerait pas de si tôt et son père lèverait la main sur lui. Non, et puis il avait trop peur de sortir seul ; il préférait encore rester à l’appartement et mourir de soif.
Il ferma le réfrigérateur puis le rouvrit aussitôt, empoigna la bouteille de lait et se versa un grand verre qu’il bu d’un trait avec délice. C’était fait. La bêtise était consommée. Il se resservit alors un second verre car autant qu’il le savait, l’intensité des raclées qu’il recevait n’était pas proportionnelle à la gravité de la sottise. David bu cette fois-ci plus lentement, appréciant la descente du liquide laiteux le long de sa gorge. La bouteille était maintenant à moitié vide.
Il rangea le tout et alla se lover dans l’espèce de long siège, élimé, défoncé, nauséabond, bringuebalant sous les fesses, poisseux sous les doigts et hideux pour le regard que ses parents désignaient sous le doux nom de canapé. La calme avant la tempête. La douceur de se pelotonner comme un petit chat avant la rudesse des coups. Il resta là de longues heures hébété de fatigue, de stupeur et par la froideur de l’appartement car le poêle qui servait à chauffer les lieux n’avait plus de combustible depuis trois jours.
Il était résigné de la vie, comme une mouche à qui on aurait ôté les ailes et qui tournerait sans fin sur une table engluée dans une tristesse et une lassitude infinie, dans un monde d’adultes tyranniques, odieux et sans cœur.
Son père rentra le soir, bien après sa mère, et se coucha sans avoir remarqué qu’il avait bu du lait dans la journée. Sa mère gueula qu’il était soul et qu’il avait bu la paye au bistrot. Sa mère se vautra aussi dans son lit et il fit de même.
Il pouvait à présent biffer sur le calendrier de sa misérable existence, une journée de plus. -
Condamné à mort !
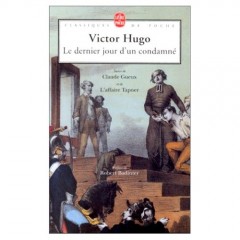 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Condamné à mort ! Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids ! ». Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné.
Condamné à mort ! Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids ! Je tourne en rond dans ma cellule, la guillotine est là, fière, arrogante ; je m’arrête, ferme les yeux puis les rouvre, elle est toujours là. Elle me suit, m’épie, sonde mon cœur, écoute ma raison et ne me lâche plus. Elle est ici, là, là-bas et encore là. Elle est partout à la fois. Elle a l’ubiquité de l’air qui rentre dans ma cellule, de la lumière qui s’introduit avec pudeur pour éclairer un peu les murs humides, gris et sales, les murs qui m’enferment, les murs entaillés par les ongles des captifs qui sont passés par ici.
J’étais un homme. Je ne suis plus qu’une âme triste, vide, creuse, dépouillée de tout ce qui m’a appartenu. Je ne suis plus rien. Pas même un nom sur une liste. Je ne suis qu’un matricule. Un numéro qu’on rayera dans quelques jours d’un trait de crayon. Un numéro qu’on oubliera bien vite, un corps qu’on jettera à la fosse commune dans l’anonymat des ossements déjà présents. Je ne serai alors plus qu’un cadavre pourrissant à cinq pieds de profondeur avec un peu de terre fraîchement retournée pour seul souvenir d’une vie d’homme qu’on a ôté.
-
L'aube surprit Angélo béat et muet mais réveillé
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« L’aube surprit Angélo béat et muet mais réveillé. ». Jean Giono, Le hussard sur le toit.
L’aube surprit Angélo béat et muet mais réveillé. Il s’était enroulé dans une grossière couverture de bure, et avait passé la nuit sous un arbre chenu aux racines tracassées. Le soleil rougeâtre franchissait l’horizon et la découpait comme une ombre chinoise, finement ciselée comme par un géant aux doigts de fées. Le spectacle était saisissant et Angelo resta là, debout, sans dire un mot, observant, fouillant l’horizon de son regard, scrutant comme un nouveau-né ébloui par la lumière du jour. Le ciel était bariolé, rougeâtre et aveuglant autour de l’astre du jour, orange et jaune plus haut et encore plus haut, il avait des reflets bleu et vert. Un spectacle divin.
Quand il ne parvint plus à fixer l’horizon, ébloui, aveuglé par tant de lumière, il s’assit et rangea ses affaires dans son sac de toile. Il n’y voyait plus clair tant il avait scruté la portion du ciel où le soleil avait marqué au fer rouge de son incandescence, de reflets soufreux et sanguines, aveuglants et éblouissants. Il jeta son sac sur ses épaules et se mit en route.
Au dessus de lui, le ciel ennuagé, orangé et violet, était pareil à un immense tapis de banquise que quelque cétacé aurait traversé pour venir respirer. Et il imagina un ballet gigantesque, une chorégraphie aquatique, de ventres gris et blancs s’arrondissant et glissant sous la surface de la glace, de dos, de rorquals, de bélugas et de narvals, d’orques et de phoques, sautant, bondissant comme des diables de leur boite au-dessus de la banquise et tous ces noms résonnaient pour lui comme des trésors venant du pays des grands froids.
Il chassa de sa tête cette féérie et continua son chemin, descendant une pente abrupte et caillouteuse qui débouchait sur une vallée verdoyante et qui surplombait le plateau où il avait passé la nuit. Il marcha longtemps s’enfonçant dans des broussailles, s’écartant du chemin pour éviter de rencontrer les troupes de l’armée régulière. Sa progression était ralentie mais c’était beaucoup plus sûr pour sa personne. S’il avait été pris, il aurait été fusillé sur le champ : la mort, c’est le funèbre sort que toutes les armées du monde réservent et réservèrent à toute époque à leurs déserteurs.
Ereinté, les pieds lourds, la peau halitueuse et la bouche sèche, il fit une halte pour se reposer et boire un peu d’eau. Le ciel s’était dégagé, balayé par un vent sec d’ouest et le soleil qui commençait à être haut dans le ciel, calcinait toute la plaine comme une côtelette abandonnée sur des braises. Il s’assit, cala son dos le long du tronc d’un arbre et souffla un moment, quand il entendit soudainement une détonation assourdissante. Le ciel s’embrasa dans sa totalité, un flash lumineux incroyable comme si l’astre du jour avait brusquement occupé tout l’horizon. Angélo, aveuglé, ferma les yeux et attendit, impuissant. Il pensa à une explosion. Cela ne dura pas et la luminosité diminua. Mais un souffle dévastateur, un choc effroyable, arrivait sur lui à une vitesse prodigieuse, couchant à son passage, les arbres, les arbustes, toutes les plantes. Il fut projeté au sol. Angélo eut l’impression que ses tympans explosaient et qu’une main invisible le cuisait comme une vulgaire grillade. Les oreilles en sang, le corps brûlé, titubant, il se retourna et vit avec effroi un immense champignon noir et sale s’élever, gonfler comme un ballon de baudruche, noircir le ciel de sa funeste couleur.
Et les dernières paroles d’Angélo furent : « Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un vent violent. *»* L’apocalypse de Jean
-
Doukipudonktan
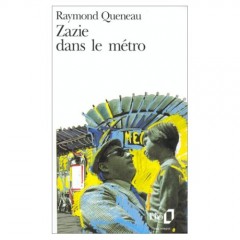 A partir de la première phrase d'un roman, et de toute la fin en gras, écrire une nouvelle.
A partir de la première phrase d'un roman, et de toute la fin en gras, écrire une nouvelle.
« Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé. ». Queneau, Zazie dans le métro.
Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé. Il avait pourtant le nez collé à la vitre, prêt à humer la moindre parcelle d’air frais qui se présenterait à son tarin, mais il ne comprenait pas comment tous ces vieux pouvaient sentir aussi mauvais. Un mélange de sueur, de renfermé, de ranci et de vieux. Peut-être ne sortent-ils pas assez régulièrement ? Il faudrait les aérer, les pendre à la fenêtre comme des draps sales puis mettre le tout dans le tambour du lave-linge et choisir un bon essorage, de quoi les faire tourner tous ces vieux puants, comme la mayonnaise.
Voilà, il l’avait pensé. Avait-il des remords ? Nullement. Cela faisait bien huit heures, qu’il était rivé à son siège, à ne penser qu’à ça. Alors il avait bien le droit sans dire un mot, de leur faire quelques petites misères à tous ces vieux croulants qui usent leur vieille carcasse déglinguée à traîner dans des cars en partance pour le Maroc, à risquer au moindre pas de se fêler ou mieux désagréger leur tibia ostéoporotique, et qui soulent tout le monde, les guides, le chauffeur, le personnel de l’hôtel avec toutes leurs petites misères, leurs histoires surannées et leurs tics de langage. Je les entends, je les entends tout le temps. « René, tu te rappelles avoir rempli le bol de pépète ? », « Maurice, l’auto-bronzant, tu l’as mis dans le sac ? », « Jeanne, j’ai un doute, je ne me rappelle pas avoir éteint la liseuse. Si c’est le cas, les piles seront vides ; ça me tracasse, je ne pourrai plus faire les mots croisés du Télépoche ». D’ailleurs, il n’y a pas qu’eux que j’entends sans arrêt, il y a aussi le commercial : « Une place qui se libère à ce tarif, vous ne le regretterez pas monsieur. Vous serez avec des retraités. Vous verrez, de la tranquillité, du calme, des vacances DE REVE ! »
Si je pouvais, je lui mettrai un bon coup de pied au cul à ce commercial, et hop ! dans le car à prendre ma place dans ce contre-pied de Grâce, dans ce car puant bourré de vieux cacochymes, sur-vitaminés mais faisandés à l’intérieur, dans ce car aux relents de moiteur, et de je ne sais quoi de dégueulasse.
Le lendemain, je réussissais à dénicher des feuilles de menthe. Ce n’était pas pour me faire des infusions de thé, l’heure était grave, il fallait que je me remplisse les poches, de la chemisette, du bermuda, toutes mes poches, que je garnisse tout ce que je pouvais de ces feuilles aromatiques. Et la vieille qui s’assit à mes côtés (ce n’était jamais la même : les veuves devaient tirer au sort pour ne pas se battre), me dit tout à trac :
— Qu’est-ce qui pue comme ça ?
— Ça ptite mère, ce sont des feuilles de menthe de Marrakech, les meilleures qui soient, lui répondis-je.
— Ça devrait pas être permis d’empester le monde comme ça, continua la nonagénaire.
— « Si je comprends bien, ptite mère, tu crois que ton parfum naturel fait la pige à celui des rosiers. Eh bien, tu te trompes, ptite mère, tu te trompes.
— T’entends ça ? dit la bonne femme à un ptit type à côté d’elle, probablement celui qu’avait le droit de la grimper légalement. T’entends comme il me manque de respect, ce gros cochon.
Le ptit type examina le gabarit de Gabriel et se dit c’est un malabar, mais les malabars c’est toujours bon, ça profite jamais de leur force, ça serait lâche de leur part. Tout faraud, il cria :
— Tu pues, eh gorille.
Gabriel soupira. Encore faire appel à la violence. Ça le dégoutait cette contrainte. Depuis l’hominisation première, ça n’avait jamais arrêté. Mais enfin fallait ce qu’il fallait. C’était pas de sa faute à lui, Gabriel, si c’était toujours les faibles qui emmerdaient le monde. Il allait tout de même laisser une chance au moucheron.
— Répète un peu voir, qu’il dit Gabriel.
Un peu étonné que le costaud répliquât, le ptit type prit le temps de fignoler la réponse que voici :
— Répéter un peu quoi ?
Pas mécontent de sa formule, le ptit type. Seulement l’armoire à glace insistait : elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe monophasée :
— Skeutadittaleur…
Le ptit type se mit à craindre ? C’était le temps pour lui, c’était le moment de se forger quelque bouclier verbal. Le premier qu’il trouva fut un alexandrin :
— D’abord, je vous permets pas de me tutoyer.
— Foireux, réplique Gabriel avec simplicité ». -
La Princesse du sang

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« L’Oldsmobile noire roulait avec soin sur le sable d’une plage ». Jean-Patrick Manchette, La Princesse du sang.
L’Oldsmobile noire roulait avec soin sur le sable d’une plage. Personne sur la grève hormis la lourde automobile aux plaques du Texas qui roulait au ralenti, phares éteints, précautionneusement. La marée était descendante et les pneus ne s’enfonçaient guère dans le sable encore humide. Dans le véhicule, deux personnes à l’avant, et deux à l’arrière qui encadraient une jeune femme. Cette dernière, bâillonnée, les mains entravées, de longs cheveux bistre, une figure oblongue, comme un tableau d’Amedo Modigliani, pâle, au regard atone ; elle semblait avoir été droguée. Les autres occupants ne disaient mot. De temps à autre, ils se faisaient comprendre par geste, comme si chaque mot prononcé, chaque parole dite, pouvait avoir de mortelles résonances sous le pavillon de l’américaine.
Plus loin le moutonnement des vagues paraissait presque irréel dans la noirceur de la nuit. Près d’une habitation qui apparut au détour du chemin, à proximité d’une dune difforme, hérissée d’oyats, l’automobile noire stoppa. Le plus trapu des hommes ouvrit la marche, les portières ne furent pas claquer et un des gars chargea la jeune femme sur ses épaules comme un sac de ciment tandis que les autres semblaient aux aguets prêts à faire usage de leur arme de poing. La bedonnante voiture, aux généreuses ailes, fut poussée dans un des garages : ils ne voulurent pas redémarrer l’imposant V6 de l’Oldsmobile.
La troupe pénétra dans la demeure, à pas feutrés mais promptement. Toutes les issues furent fermées. Et la jeune femme fut allongée sur un lit où on lui retira ses liens et son bâillon. Elle était encore inconsciente. Ils ne l'avaient pas attacher par plaisir mais dans le cas où elle aurait crié en se réveillant.
— Nous sommes coincés là jusqu’à demain, dit un des hommes.
— Quand il fera jour, nous laisserons les volets fermés et quand la nuit viendra, nous partirons discrètement, répondit un deuxième homme.
— Encore une journée, à se tourner les pouces ici ? dit un troisième.
— Oui, et c’est notre job, quelque chose à ajouter ? dit le premier des hommes qui avait parlé.
Les autres acquiescèrent et vaquèrent à leur occupation. Les heures passèrent et un silence angoissant baigna la maison, à peine troublé par le craquement aléatoire des boiseries. Ces dernières étaient malmenées par les assauts du vent qui s’était subitement levé avec les premiers rayons du soleil. La jeune femme se réveilla dans la matinée sans réaliser où elle se trouvait. Ils lui préparèrent un petit déjeuner, et lui expliquèrent calmement, qu’ils l’avaient mis en lieu sûr car de sérieuses menaces pesées sur sa vie.
Les hommes des services spéciaux étaient entrés en coup de vent dans sa vie et ils en sortirent le soir même de la même manière après lui avoir expliqué les recommandations à suivre.
Elle resta là, enfermée dans la maison, pendant quelques semaines. Les réserves de nourriture étaient amplement suffisantes et la veille qu’ils reviennent la chercher pour une autre planque, la jeune femme décida d’aller faire une balade le long de la mer.
Le lendemain, les hommes des services spéciaux trouvèrent porte close et aucune trace de la jeune femme.
Elle ne fut jamais retrouvée.
S’était-elle noyée ? L’avait-on enlevé ?
Nul ne le sera jamais. -
Roméo et Juliette
 Un extrait de Roméo et Juliette, Acte I, Scène V , de William Shakespeare
Un extrait de Roméo et Juliette, Acte I, Scène V , de William Shakespeare
"Roméo, prenant la main de Juliette. — Si j’ai profané avec mon indigne main cette châsse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence : permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d’effacer ce grossier attouchement part un tendre baiser.
Juliette. — Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main qui n’a fait preuve en ceci que d’une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins ; et cette étreinte est un pieux baiser.
Roméo. — Les saintes n’ont-elles pas des lèvres, et les pèlerins aussi ?
Juliette. — Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière.
Roméo. — Oh ! alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient ; exauce-les, de peur que leur foi ne se change en désespoir.
Juliette. — Les saintes restent immobiles, tout en exauçant les prières.
Roméo. — Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l’effet de ma prière (il l’embrasse sur la bouche). Vos lèvres ont effacé le péché des miennes.
Juliette. — Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu’elles ont pris des vôtres.
Roméo. — Vous avez pris le péché de mes lèvres ? O reproche charmant ! Alors rendez-moi mon péché. (Il l’embrasse encore.)
Juliette. — Vous avez l’art des baisers.
La Nourrice, à Juliette. — Madame, votre mère voudrait vous dire un mot. (Juliette se dirige vers lady Capulet.)
Roméo, à la nourrice. — Qui donc est sa mère ?
La Nourrice. — Eh bien, bachelier, sa mère est la maîtresse de maison, une bonne dame, et sage et vertueuse ; j’ai nourri sa fille, celle avec qui vous causiez ; je vais vous dire : celui qui parviendra à mettre la main sur elle pourra faire sonner les écus.
Roméo. — C’est une Capulet ! O très chère créance ! Ma vie est due à mon ennemie !
Benvelio, à Roméo. — Allons, partons ; la fête est à sa fin.
Roméo, à part. — Hélas ! oui, et mon trouble est à son comble".

-
On fait glisser les pages en ployant légèrement le livre ou le cahier
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« On fait glisser les pages en ployant légèrement le livre ou le cahier », Philippe Beaussant, Le rendez-vous de Venise.
On fait glisser les pages en ployant légèrement le livre ou le cahier. Et le pouce comme un butoir de chemin de fer, stoppe les wagons récalcitrants en un arrêt brusque. Le papier se froisse et nous découvrons, aux hasards du voyage, ce qui est couché sur les pages blanches en traces noires.
Pour monter au grenier, il y avait un escalier raide constitué de vieilles marches qui grinçaient sous les pas comme les dents de mon papy. La nuit, quand je ne parvenais pas à m’endormir rapidement, je l’entendais, blotti sous l’amoncellement de couvertures que grand-mère laissait sur chaque lit — il y en avait trois — dans la pièce du fond : en effet, à cette époque, réminiscence des temps difficiles que furent la seconde guerre mondiale, il n’y avait pas de chauffage dans les chambres à coucher la nuit. Et d’ailleurs, que c’était agréable de plonger dans l’océan glacial, le lit des grands, de grelotter comme un pantin désarticulé et de se réchauffer par sa propre chaleur, piégée par cette montagne de chiffons.
Au grenier, un univers de vielles choses remplissait la pièce. Il y avait de tout, des piles de vieux journaux, un canapé sur lequel on pouvait s’asseoir, des livres, des cartons de vêtements, des armoires pleines de bric-à-brac, une vieille machine à coudre à pédale, et un tas de choses dont je n’ai plus souvenir mais l’ordre y régnait. Des tapis avaient été glissés sous les meubles, des couvertures protégeaient de la poussière et des souris quelques cartons et tous les meubles semblaient avoir été disposés pour une bonne circulation dans le grenier. On se serait cru dans une vieille pièce abandonnée mais visitée de temps à autre par quelque fantôme, spectre ou personne d’une autre époque.
Dans le coin gauche, une grande et belle malle reposait sur un tapis élimé. J’y plongeai les mains, découvrant des livres que je ramenai à la surface avec délicatesse et presque religieusement. Je prenais garde de les poser à côté de la malle dans la même disposition dont ils se trouvaient auparavant : les pages jaunies m’inspiraient davantage de respect que les livres de la bibliothèque de mes grands parents qui se trouvait au rez-de-chaussée, près de la cheminée. Et parmi les différents ouvrages, j’exhumai un vieux carnet à la couverture rougeâtre et cartonnée.
Je le regardai comme un trésor ne m’avisant pas d’y toucher et c’est au bout de plusieurs minutes que je consentis à tourner les pages, avec la fièvre au front, de l’énigmatique carnet. Et je n’aurais jamais osé, comme je le faisais avec mes livres, faire glisser les feuillets à toute vitesse pour s’arrêter au détour d’une page.
Non, délicatement, précautionneusement, je tournai les pages du carnet m’attendant à chaque fois qu’un feuillet parte en poussière. Ce carnet appartenait à ma grand-mère. C’était un journal intime, le journal d’une jeune fille qu’avait été ma grand-mère. Et à mon grand étonnement, j’appris des choses sur l’amour, sur les hommes et les femmes.
Et j’appris aussi que ma grand-mère avait aimé d’autres hommes que mon grand-père. Ce fut une grande surprise.
C’est de cette époque, que je compris qu’on était pas obligé dans une vie d’aimer qu’une seule personne comme dans les contes pour enfants mais que le cœur pouvait embrasser plusieurs amours. -
Bannissement
 Le soleil commence à poindre et de ma place, je cligne des yeux pour ne pas être ébloui. Michel, qui s’est allongé un peu plus loin, se réveille aussi. Il m’engueule car il ne retrouve plus sa bouteille. Je l’entends maugréer, taper dans ses cartons et jurer comme un charretier. Je n’y prête même plus attention. D’ailleurs, tout m’indiffère.
Le soleil commence à poindre et de ma place, je cligne des yeux pour ne pas être ébloui. Michel, qui s’est allongé un peu plus loin, se réveille aussi. Il m’engueule car il ne retrouve plus sa bouteille. Je l’entends maugréer, taper dans ses cartons et jurer comme un charretier. Je n’y prête même plus attention. D’ailleurs, tout m’indiffère.
Le ciel est clair et l’air est frais, ce matin. On doit être en octobre. Enfin, à peu de chose près. Michel, mon compagnon d’infortune, mon bon samaritain, comme je l’appelle car il m’a sauvé d’une mort certaine l’hiver dernier tandis que je m’étais assoupi sur le trottoir, un soir de nouvelle lune où il gela sévèrement, Michel n’est de pas de bonne humeur. Ses engelures aux pieds doivent le faire souffrir. Il ne veut pas m’en parler mais je suis sûr qu’il a des crevasses. Ses lésions rouge violacé et étendues n’étaient pas belles à voir la semaine dernière et ça n’a pas dû s’améliorer.
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que je suis dans la rue. Avant j’étais ingénieur dans une grande société d’électronique mais la jeunesse sans doute, l’inconscience aussi, m’ont fait déraper : j’ai écris des informations confidentielles et malveillantes sur la nouvelle génération de puce dans mon blog. Je crois que je n’avais pas mesuré la portée de mes actes. La sanction a été sévère mais même si je ne voulais pas me l’avouer, par orgueil, je savais que cela finirait ainsi. Autodestruction peut être.
Et le surlendemain de la parution de l’article dans le blog, ils ont coupé ma puce par satellite. La puce sous cutanée RFID III pour radio frequency identification de 3ème génération, celle qui équipe tous les humains sur Terre depuis 2021, et le Verichip Act III.
Je suis à présent un banni, un apatride, un errant qui fait les poubelles, qui quémande sa nourriture car cela fait longtemps que les SDF comme on les appelait avant, ne mendient plus d’argent car la monnaie et avec elle, les billets et les pièces, a cessé d’exister en 2016. Maintenant c’est l’ère de l’argent virtuel, l’ère de l’argent des puces RFID.
Mes journées avec Michel sont toutes des répétitions d’une même et unique journée hideuse : de l’alcool, de la crasse, de la faim, du froid mordant ou de la chaleur poisseuse, de l’envie, du dégoût pour soi, du regard des autres ou plutôt de l’absence de regard et de l’humiliation et marcher, marcher pour trouver un abri, marcher pour trouver de la nourriture, marcher pour tromper l’ennui, marcher tout court, marcher toujours.
Quand le gouvernement m’a coupé ma puce, j’ai perdu en un instant mon compte en banque, mon appartement, tous mes biens, mon travail, mes droits civiques, la garde de mes enfants. Mon mariage a été instantanément dissous. Je ne peux plus me marier bien évidemment, je ne peux plus agir en justice ou reconnaître des enfants, je ne peux même plus travailler. Je ne suis plus rien. Je suis un banni. Je suis mort civilement. Je suis mort pour la société. Je n’existe plus.
Ma famille n’a rien pu faire mais à vrai dire, je ne sais pas si mon épouse était prête à aller en prison si elle s’était opposée à mon bannissement. De toute manière, elle ne l’a pas fait et je préfère ainsi.
Le seul avantage, si on peut dire, c’est qu’à présent je suis un homme libre : plus aucun et foutu satellite ne peut me suivre à la trace comme pour tous les autres citoyens mais comme dit Michel, c’est une piètre consolation.
-
Mi-avril
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.« Solange me répétait souvent, ces derniers temps, comme à peu près chaque année vers la mi-avril, qu’il allait falloir bientôt se méfier de la douceur de l’air » Jean-Pierre Martinet, Jérôme
Solange me répétait souvent, ces derniers temps, comme à peu près chaque année vers la mi-avril, qu’il allait falloir bientôt se méfier de la montée de la sève des plantes. Avec une précision de métronome, tous les jours, elle allait s’asseoir sur un petit tabouret métallique de couleur crème qu’elle disposait au ras des doubles rideaux, lissait de la main gauche sa longue chevelure brune et contemplait notre jardin de longs moments, à s’étrécir la prunelle des yeux. C’était une quasi extase. Les rondeurs des haies, les bourgeons qui poignaient, la pelouse qui prenait des couleurs, le pépiement des jeunes oiseaux qui retentissait de nouveau, tout cela la revigorait comme une bonne tasse de chocolat chaud. Son printemps, elle le devinait derrière la fenêtre, l’imaginait, le modelait comme une statue en argile. Et quand elle se l’était bien appropriée, s’étant faite à l’idée que les jours étaient à présent suffisamment longs, que le fond de l’air était suffisamment doux alors elle pouvait ouvrir la baie vitrée et faire quelques pas dans notre jardin.
Avant cette appropriation, elle était d’une nervosité exacerbée. Elle chuchotait sur son tabouret des phrases comme : « Comment pourrons-nous sortir et écraser les fragiles brins d’herbe ? », « Ne crois-tu pas que les Dujardin vont tailler leur haie, ne pourrions-nous pas en faire autant ? », « Il faudrait nettoyer la mangeoire à oiseaux, il fait maintenant suffisamment doux ». J’acquiesçais, ne voulant pas la chagriner mais je savais bien, qu’au fond, elle crevait de peur. Elle crevait de peur parce qu’un nouveau printemps frappait à notre porte, ce qui devait signifier beaucoup pour elle. Une année venait de s’écouler. Les trotteuses de sa vie n’en finissaient pas de tourner comme la terre autour de ses pôles.
Alors d’un mot gentil, d’une caresse aimable, d’un regard d’apaisement, je la rassurais et elle oubliait pour un instant ce qu’elle cherchait en scrutant à travers le double vitrage. Elle se levait, réajustait sa jupe sombre et allait s’asseoir dans le canapé, où je l’entendais souffler doucement, comme un murmure qui s’échappe. Et c’était dans ces instants précieux de mi-avril, que je réalisais que je ne pourrais pas vivre sans elle et que j’aimais à penser qu’elle ne pourrait pas vivre sans moi. Enfin, je l’espérais. -
Pourquoi écrire ?
 "Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".
"Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".John Maxwell Coetzee, Doubler le cap
-
La fourgonnette
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Nous roulions depuis une trentaine de kilomètres lorsqu’un couinement nous est parvenu depuis l’arrière » Philippe Ségur, Vacance au pays perdu.
Nous roulions depuis une trentaine de kilomètres lorsqu’un couinement nous est parvenu depuis l’arrière. Je regardai Marie qui fit la moue : j’étais aussi dubitatif qu’elle et n’accordai aucune importance à ce bruit étrange. Je continuai de rouler tout à fait normalement. Et je repensai même à ce que nous allions faire ensuite. Mon épouse s’était endimanchée, maquillée et parfumée plus que de raison pour cette occasion.
Le soleil ourlait une lumière orange vers l’ouest où nous nous dirigions avec la fourgonnette et où l’astre du jour commençait à décliner. Plus au nord, le ciel s’ennuageait un peu avec des cirrus qui semblaient s’étirer dans le ciel comme une volée d’oiseaux migrateurs. Je baissai le regard pour aborder le virage qui s’annonçait quand de nouveau un couinement retentit, un peu comme un grincement de porte.
Cette fois-ci nous n’avions pas rêvé. Pourtant tout s’était passé normalement pendant le chargement et nous avions fait ce qu’il fallait pour qu’il ne fasse pas de bruit. Nous l’avions bien attaché, solidement et nous avions tout fait pour que nous ne puissions pas l’entendre pendant le trajet. Qu’est ce qu’il pouvait bien faire à l’arrière de notre camionnette ?
Nous nous regardâmes, moi et mon épouse, ne sachant pas quoi faire. Je stoppai alors notre véhicule sur le côté, vérifiant que Manon, qui s’était lovée entre nous, dormait encore. Cela fait, je descendis, ouvrit la porte arrière le plus silencieusement possible, vérifiai qu’il était bien attaché, ce qui était le cas et qu’il ne pouvait pas se faire entendre.
Nous repartîmes le plus discrètement possible. Je ne roulai pas vite, ne voulant pas réveiller Manon. Quelques kilomètres plus tard, nous arrivions à la ferme.
Marie s’occupa de la petite, fatiguée par la route, qu’elle déposa dans le canapé. Je me chargeai du « colis ».
Et qu’elle fut la surprise de Manon, quand elle découvrit le paquet cadeau, déposé à ses pieds par nos soins sans avoir fait le moindre bruit.
Nous eûmes droit à un « Ho ! » de joie et des grands éclats de rire.
Bien des années plus tard, elle nous confia que cela avait été l’un de ses plus beaux anniversaires.Elle s’appelait Espérance : onze kilos, le poil beige, un jolie Labrador femelle de six mois que nous avions été chercher au refuge. J’avais dû lui enfiler une méchante muselière pour ne pas que Manon l’entende !
Quant au couinement, c’était sans doute la caisse à outils métallique qu’Espérance avait déplacé avec ses pattes pendant le trajet. -
La vieille machine à écrire Underwood
J’avais une vieille machine à écrire, une Underwood, qui prenait la poussière au grenier. Elle venait de ma tante Germaine, qui avait pris l’habitude de taper de petits textes avec celle-ci, pour ses pots de confiture, pour ses conserves, pour le rangement des outils de son mari… Le souci du perfectionnement, sans doute.
La tante Germaine nous avait mis en garde de ne jamais utiliser cette vieille Underwood mais c’était juste avant son décès, une noyade, bête et inexplicable, dans sa baignoire en fonte et personne n’y prêta attention sachant que la tante Germaine sur la fin, n’avait plus toute sa tête.
Je finis, je ne sais plus comment, par récupérer entre autre cette machine à écrire et, ne voulant pas la jeter, elle se retrouva oubliée sous une couverture au grenier pendant de longues années.
Evidemment, on remplit son grenier, d’un tas de choses, souvent inutiles ou cassées, de babioles dont on aurait du se débarrasser et dont on ne se servira sans doute plus jamais. Tout cela dort, là-haut, au-dessus de nos têtes, dans un amoncellement de cartons et quand on finit par faire un peu de rangement, le grenier étant plein à craquer, on retrouve avec ravissement de vieilles bricoles qu’on prend presque pour des reliques.
J’avais, en triant, jeté beaucoup mais je ne pouvais me résoudre à me séparer de la vieille Underwood avec ses touches rondes et blanches, sa bouille prognathe, étalant son clavier comme les dents chez le dentiste, et son gros rouleau surplombant sa vieille carcasse. Plus je la regardais, plus elle semblait m’inviter à la descendre dans mon bureau, ce que je consentis à faire.
C’était puéril car je n’en avais aucune utilité. Cette pauvre machine des années 1920 ne supportait aucune comparaison face à mon PC assisté d'une imprimante laser.
Je disposai l’antédiluvienne machine dans un coin de mon bureau. Et une remarque de mon épouse ne se fit pas attendre :
— Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? me dit-elle.
— Une Underwood, lui répondis-je.
— Une Underwood. Et que comptes-tu en faire ? reprit-elle.
— Je n’en sais rien.
— Tu vas me faire le plaisir de t’en débarrasser.
Elle regarda la machine puis rajouta :
— Je ne l’aime pas cette machine. On dirait qu’elle me fixe.
Et je repris en lui demandant, comment elle pouvait ne pas aimer une machine à écrire, et comment une machine à écrire pouvait la fixer. Je mis tout cela sur le compte de la fatigue et elle s’énerva ; nous nous engueulâmes mais l’Underwood resta sur mon bureau. Le lendemain, je m’amusai même à taper dessus la liste des courses et surprise, le clavier fonctionnait à merveille ! J’avais auparavant retrouvé un vieux ruban dans un des tiroirs de mon secrétaire. L’après-midi, j’allai faire les courses à l’hypermarché, avec ma liste tapée avec la vieille machine et j’attendis une heure aux caisses : bug informatique. L’électronique n’est finalement pas aussi sûre qu’une bonne vieille mécanique…
Quelques jours plus tard, je me resservis de l’Underwood pour taper, pour le plaisir, le cours de français de Caroline. Je lui avais bien entendu demandé auparavant si je pouvais le faire… Et le lendemain soir, je l’attendais avec impatience, pour lui demander si je n’avais pas fait de fautes sur les deux feuillets que je lui avais tapés pour son cours. Elle avait une mine décomposée, les cheveux défaits, les yeux humides et m’expliqua, en sanglotant, que ça avait été les pires heures de cours de toute sa carrière et qu’elle ne comprenait pas ce qui avait littéralement déchaîné les collégiens à son encontre.
Je laissai de côté la machine à écrire, déçu. Il y eut les vacances de Pâques à la mer et l’Underwood sortit de mon esprit.
Je touchai de nouveau son clavier fin d’avril, pour taper une facture pour l’assistante maternelle que je déposai le soir même. Le lendemain, elle nous appelait, catastrophée de ne pas pouvoir garder notre bébé, elle était à l’hôpital, s’étant faite une luxation de la rotule du genou en revenant de la boite aux lettres.
Plusieurs semaines plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de Caroline, j’en profitai pour taper un petit mot doux avec la vieille machine à écrire de ma tante. Ce fut la dernière fois, que j’utilisai cette maudite machine. Evidemment, j’ai peine à croire qu’une machine puisse faire quoi que ce soit à notre encontre, qu’elle soit douée d’une capacité à faire le mal mais encore aujourd’hui, je repense à la mise en garde de ma tante Germaine et bien que je ne sois pas du tout superstitieux, j’ai des doutes.
Après avoir lu son petit mot et déballé son cadeau, Caroline s’est effondrée brutalement. Les médecins ont conclu à un AVC, c'est-à-dire une attaque cérébrale.
Cela fait maintenant un an, jour pour jour, qu’elle nous a quittés. -
La grange
 La première phrase « C’était là qu’était dressée la table » est tirée du roman d’Elsa Triolet, Roses à crédit, 1959
La première phrase « C’était là qu’était dressée la table » est tirée du roman d’Elsa Triolet, Roses à crédit, 1959
C’était là qu’était dressée la table. Près d’un parterre de fleurs bariolées (j’imaginai que les graines du jardinier étaient tombées de sa poche trouée et j’en souris) et sous un vieux pommier qui en plus de nous faire de l’ombre, nous décochait régulièrement de petites pommes à cidre sur la tête ; ce qui apparemment exaspérait mon voisin de gauche, au teint pâle, taciturne et peu prolixe, qui non seulement ne profitait guère de l’ombre, étant mal placé sous une trouée de branches mais recevait beaucoup de projectiles ce que je ne pouvais expliquer.
Mon voisin de droite était plus bavard et parlait tellement, qu’il n’attendait même pas mes réponses pour passer du coq à l’âne, ou plutôt devrais-je dire du zizi au derrière car finalement tout tournait autour du sexe et toutes ses plaisanteries finissaient en propos graveleux. Je prenais ça avec philosophie, n’étant pas un fervent admirateur de ses blagues mais mon voisin de gauche soufflait bruyamment croyant pouvoir stopper la logorrhée du casse-pieds.
A côté de la grande table, qui consistait plus en l’assemblage un peu bancal de vieilles tables sur lesquelles on avait jeté une nappe immaculée, un chemin de gravillons menait à une grange, laide et ancienne. Ce petit chemin tortueux contournait un parterre de fraises des bois qui s’épanouissaient, les pieds dans l’eau, près d’une source qui affleurait à peine. Après le repas qui fut délicieux, réveillé par le café, et ragaillardi par la traditionnelle eau de vie, nous allâmes nous aérer l’esprit et je remarquai de loin que mon voisin de gauche, continuait de maugréer, s’étant trouvé un voisin de table qui semblait réceptif à son caractère grincheux. En s’approchant, la grange flanquée d’un appentis au-dessous duquel trônait fièrement de belles et grosses buches, offrait au regard un aspect plus flatteur : sa haute stature clouait les rais de lumière comme de vulgaires fils sur la toiture : une belle et agréable pénombre en résultait et une végétation verte et luxuriante s’était épanouie sur cette terre humide et accueillante. J’explorai un peu cette verdure constituée de haies touffues, d’arbustes et d’herbes folles autour de laquelle montaient d’agréables fragrances, comme des pétales de roses dans le vent, que j’humai avec plaisir puis je revins sur mes pas non sans jeter un dernier coup d’œil à cette grange. Odeur de bois humide, de feuilles, de terre, de plantes aromatiques peut-être, constituait un mélange subtil et enivrant qui resta présent encore un moment à mon esprit et seul mon voisin de gauche réussit à chasser cela, car en m’asseyant, je constatai qu’il renaudait toujours.
Je finis par m’assoupir, délicieusement réchauffé par la lumière du soleil qui commençait à poindre sur le côté du pommier, en me demandant comment pouvait-on être aussi être ronchon quand la nature nous offre, à portée de main, de petits trésors. -
Le vieux sage

Il y a longtemps et dans de lointaines contrées, vivait une tribu en harmonie avec la terre, le ciel et l’eau. En ce temps-là, l’eau des rivières et des sources était limpide et l’on y pouvait boire sans risquer d’être malade. L’air était frais et pur, le sol était fertile et la terre offrait à ceux qui savaient la cultiver de beaux fruits et légumes. Evidemment, tout n’était pas idyllique. Parfois la mort venait frapper à la porte de la communauté, avec son lot de guerres et d’épidémies. Mais la vie y était le plus souvent paisible et agréable.
Dans cette ancestrale tribu, vivait un vieux sage que tout le monde respectait. Il savait ses jours comptés à cause de son grand âge mais il était serein car la vie lui avait apporté tout ce qu’il avait désiré : l’amour avec sa femme et ses cinq enfants, un toit à mettre au-dessus de sa tête, pour pouvoir l’abriter lui et les siens, de la pluie et du vent, de la neige et du soleil. Sa tente bariolée était d’ailleurs son seul bien. Il avait des amis fidèles sur lesquels il avait pu, tout au long de sa vie, compter. Il s’était très jeune passionné pour les choses de la nature : les animaux, et comment les chasser ou les apprivoiser, les plantes et leurs vertus médicinales, les nuages et comment prévoir le temps qu’il fera, les poissons et la pêche, la terre et comment la féconder avec des graines, le feu et la manière de le faire naitre, et c’est souvent qu’on venait lui demander conseil.
Aussi quand le vieux sage, à la barbe blanche et au dos vouté, fit des cauchemars noirs et étranges, toute la communauté s’inquiéta. Toutes les nuits, il hurlait, suait toute l’eau de son corps et prononçait d’inquiétantes paroles. Il semblait se tordre de douleur, se roulait par terre, se cognait, rampait comme le serpent, hurlait comme le chacal, bavait comme un loup. Certains soutinrent qu’il avait été envouté par l’esprit du malin, d’autres pensèrent à une mauvaise fièvre mais beaucoup, au fond de leur cœur, n’y croyaient pas. Ils avaient peur et redoutaient un grand malheur et invoquèrent les dieux pour leur miséricorde. Sa famille, ses enfants, car son épouse l’avait quitté en couche, étaient impuissants à le calmer et chaque nuit, ils lui donnaient un peu d’eau et le réconfortaient mais en vain, que si bien, une nuit sans lune, quand le loup hurle et le vent ne siffle pas, son cœur fut rappelé dans la prairie verdoyante où vont les âmes trop fatiguées par leur vie terrestre.
Les dieux furent convoqués, on chanta, dansa autour du feu et on appela les ancêtres. On fit offrande, on lui fit une sépulture et on organisa une belle cérémonie, pour calmer les cœurs et les esprits, et pour que l’âme du vieux sage parte en paix.
Bien des années plus tard, peu de gens se souvenaient de la triste fin du vieux sage quand d’étranges bonhommes surgirent sur la colline. Peu de gens se rappelèrent des mises en garde du vieux sage et de ses cauchemars inquiétants. Pourtant il les avait mis en garde sans le savoir face à un danger que personne n’aurait pu imaginer.
Dans ses rêves, il leur avait dit : « Ils viendront comme des nuées d’insectes. Ils seront pâles, méchants et bêtes. Ils ne respecteront rien : pas même la vie et la terre qui féconde, pas même l’eau qu’ils souilleront, pas même les arbres qu’ils coucheront comme le vent plie un brin d’herbe, pas même les animaux qu’ils extermineront. Facilement, vous pourrez les reconnaitre car ils auront tous un regard inquiet et triste. Toujours, ils courront après on ne sait quoi. Ils auront des armes en métal qui crachent le feu et sèmeront la mort ». -
La tête entre les mains sous l’escalier
Même si après des années, les meilleurs, nos modèles, l’ont encore, cela ne m’était d’aucun secours. Le monde s’était réduit à ces quelques mètre-carré que j’allais devoir arpenter en lâchant, ou plutôt en déglutissant, quelques paroles. J’avais quitté les autres car soutenir leur regard était maintenant au-dessus de mes forces, tel Narcisse se contemplant dans l’eau d’une source, j’avais l’impression de me voir et de voir mon angoisse à travers eux. C’était insoutenable.
Je me réfugiai donc sous les escaliers, comme un chien apeuré dans sa niche. L’obscurité quasi-totale, l’éloignement des autres, là, je me sentais un peu apaisé. Mais la boule, celle qui nouait mes viscères, ne m’avait pas quittée. Et comme tous les novices, je me demandais bien qu’elle mouche m’avait piquée pour me retrouver ici, sous un escalier, à moitié tremblant, perlant de sueur, la bouche sèche et pâteuse, la gorge irritée comme une cheminée ramonée. Non, vraiment, je l’aurais bien crié, mais ça ne se fait pas : « Mais putain, qu’est-ce que je fous là !».
Ainsi c’était dit. Mais de nouveau, cela ne m’était d’aucun secours. Mes yeux commençaient à s’habituer à la pénombre, et je pouvais à présent contempler le travail architectural de ces travailleuses de l’ombre qui aiment à croquer les moustiques, l’amoncellement des décors, costumes, accessoires, oubliés dans les recoins de ces lieux comme des épaves éparpillées sur une grève rocailleuse. Je tournais nerveusement du mieux que je pouvais dans l’exigüité de cette pièce pour tenter vainement de transformer le désarroi de mon pauvre encéphale en échauffement musculaire : mais cela eut l’effet contraire. La panique s’exacerbait.
J’arrêtai, prenant ma tête entre les mains, croyant naïvement qu’elle allait exploser comme une grenade. Et là, quand je relâchai l’emprise de mes mains sur mes oreilles, l’horreur… Des chuchotements venaient de la salle
J’aurais voulu mourir sur le champ… Oui, d’un coup. Paf ! Et plus rien. Ou être subitement sourd, ou aveugle. Que l’on me transforme en blatte ou en limace. Que le plafond se fissure et s’effondre sur ma tête, que la foudre passe à travers les prises électriques et me grille, que le vent me démembre, que le soleil me liquéfie, que l’eau me fasse gonfler comme une éponge, que les sens me quittent, que la folie me prenne. J’aurais voulu toutes les catastrophes, toutes les morts, toutes les tortures mais pas celle-là…
Je suffoquais tellement que ma respiration s’accéléra outrageusement. Et après quelques minutes, il faut bien le dire, je réalisai que c’était une bénédiction. La respiration. Comment n’y avais-je pas pensé ? Se concentrer sur sa respiration.
Evidemment ce n’était pas la panacée mais cela avait le mérite d’atténuer les effets de monsieur chamboule tout sous la boite crânienne. Et me voici, à expirer, inspirer, comme un métronome lancé sur l’allegro. Quelques minutes de ce tempo oxygéné et me voilà, tout ragaillardi.Le rideau se leva et j’en fis de même.
Les projecteurs inondèrent la scène et je montai sur le petit escalier menant à celle-ci.
Une dernière et longue hésitation, vite chassée par un bon coup au derrière et j’étais propulsé sur scène, aveuglé, pataud, tremblant, balbutiant, suant mon texte, les pieds de plomb, la machoire comme une enclume.
Mais très vite, les mots tels de petites fées bienveillantes, me soulevèrent de leurs petites ailes dorées, m’enivrèrent de leur douce chaleur maternelle, me rendirent courage et audace, force et confiance : la magie s’opérait.Et comme il arrive souvent au théâtre, je brûlais les planches après les avoir fuis.
-
Le parking
Mes jambes m’emmenèrent jusqu’au parking. Je marchai machinalement. Il y avait ce vent, déjà un peu frais pour la saison, qui cinglait mes joues. J’enfonçai mes mains dans mes poches, résigné. Le chemin, je l’avais empruntai des centaines de fois, des milliers sans doute: je ne mettais jamais amusé à faire le calcul. Mais, cinq fois par semaine, quarante-sept semaines par an, pendant vingt-cinq ans, cela doit bien faire des milliers de fois.
Je ne m’étais pas aperçu que je n’avais pas levé la tête depuis le bâtiment jusqu’à la voiture ; sans doute, avaient-ils déjà réussi à me faire croire que j’étais devenu un looser. Il y avait eu d’abord un e-mail. Glacial, impersonnel. Un style froid comme un bac à glaçons. Une appréhension m’avait envahie, un peu comme une idée vague au premier abord, mais qui sûrement devient plus précise à mesure que la matinée égrenait ses minutes à l’horloge fadasse du bureau. Je savais mais je ne voulais pas me faire à cette idée. Evidemment quand le pire vous arrive, vous ne voulez pas le digérer en une fois. Vous préférez que le morceau vous brûle l’œsophage, lentement, vous malmène l’estomac doucement et finisse par vous tordre les viscères tout aussi mollement. Une torture, en somme. Et quand mon chef m’appela dans son bureau, là mes minces espoirs volèrent en éclat comme une vitre que l’on brise. Je mettais toujours demandé comme je réagirai si la situation se présentait : hurlerai-je ? Serai-je grossier ? En fait, comme un boxer sonné, je ne pus réagir. Bouche-bée. Livide, le regardant pareil à un poisson rouge que l’on vient de foutre dans son petit bocal aux parois transparentes, que l’on vient d’introduire par la force dans ce qui va être, à présent, son univers. Et triste allait être le mien.
Je sortis machinalement les clefs de la Clio et je restai ainsi, les clefs dans le vide, le regard idiot, scrutant une brume qui s’épaississait devant moi, un avenir qui se troublait, floconneux.
Les heures passèrent. Je ne me rendis compte de rien mais je finis par démarrer. Je passai tout de même les vitesses et la voiture me conduisit jusque devant chez moi, où elle se gara. Je descendis, monta les marches et poussa la porte, la tête bouillonnante, les jambes marshmallow, le cœur lacéré. Qu’est-ce que j’allais bien pourvoir dire aux enfants et à Lucie ? -
La médiocrité
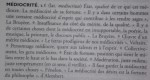 La médiocrité. Ce mot, ces quatre syllabes, me font l’idée du tranchant de la guillotine entamant la chair du pauvre supplicié. Ces syllabes tintent dans ma tête. Méchamment.
La médiocrité. Ce mot, ces quatre syllabes, me font l’idée du tranchant de la guillotine entamant la chair du pauvre supplicié. Ces syllabes tintent dans ma tête. Méchamment.Médiocrité. Cette ritournelle me donne la nausée. Pareil à une drogue que vous savez pertinemment nocive mais que vous vous évertuez à distiller dans votre corps, au goutte à goutte, chaque jour, sans jamais pouvoir vous arrêter. Voilà, c’est ma drogue, ma médiocrité. Je la cultive comme un bon jardinier qui regarde ses fruits croître et s’épanouir. Plus je la regarde en face, sans sourciller, plus elle m’est familière. Mais je crois que c’est une chose terrible pour quelqu’un comme moi, la médiocrité. Car elle me ronge, doucement, pernicieusement mais certainement. Elle me ronge de l’intérieur, tel un parasite, me rabaissant, me dévalorisant, toujours un peu plus chaque jour.
Comme si on m’avait forcé à faire ça, à coucher sur le papier tous ces mots, à tourner sans relâche les pages du dictionnaire, à vouloir à tout prix finir un roman ou une nouvelle. Me donner des armes puis me les enlever en me faisant bien comprendre que ce n’est finalement pas pour moi. « Stop, fini. Fin de l’histoire, t’est trop mauvais, va voir ailleurs, mon petit gars, c’est pas pour toi. La littérature, faut la laisser à des gens dont c’est le métier ».
Finalement je suis assez intelligent pour avoir envie d’écrire, suffisamment intelligent pour me rendre compte de ma médiocrité et trop peu intelligent pour écrire des choses intéressantes : voilà tout est dit.
J’en viens même à envier ceux qui n’ont pas de dessein. Ça doit être si simple, se lever, faire un peu de bricolage, un peu de sport, se lover dans son canapé, une couverture jetée sur ses épaules et regarder la télévision en toute simplicité et ne pas se poser de questions existentielles. Profiter du moment présent et ne pas se poser de questions. Voilà cela doit être la solution et je ne sais pas si comme Einstein, si c’était à refaire, je deviendrai plombier mais sans cesse, la question me vint à l’esprit.

