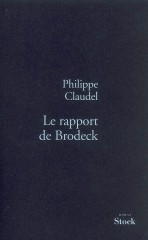
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien ». Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck.
Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Il y a des circonstances qui vous entraînent loin, trop loin sans doute et à votre insu. Comme une rivière tumultueuse qui vous charrie tel un rondin de bois, au début doucement. Avec tendresse même, vous laissant profiter du spectacle de ses berges verdoyantes, hérissées d’arbres bedonnants aux branches souples, assoiffées, ployant et touchant presque la surface de l’eau. Voyage tranquille vous permettant d’humer les senteurs provenant des rives du cours d’eau paisible : tapis bigarré d’Angéliques sauvages, Pas-d’âne, Soucis d’eau, Swerties vivaces ou grassettes communes, d’où exhalent des flagrances délicates.
Voilà un charmant voyage, vous vous dites. Mais arrivé à un méchant coude, le lit se resserre et la pente auparavant douce comme un chaton se métamorphose en redoutable tigresse. Vous ne vous promenez plus le long d’une calme et paisible rivière mais c’est un bouillonnant torrent qui vous emporte comme une vulgaire et anodine coquille de noix, ballottée, secouée dans les remous d’une rive à l’autre, entraînée par ce méchant courant. Les méandres se succèdent, les affluents aussi et on ne sait guère où le voyage va se terminer.
C’était ce voyage tumultueux semé d’embûches, inoffensif au début mais terrible ensuite qui m’avait entraîné si loin. Tout s’était enchaîné trop vite sans que je puisse reprendre mon souffle, sans que je puisse réfléchir à la portée de mes actes anodins en apparence.
Etait-ce une illusion ? Cette impression de n’y être pour rien. D’avoir laissé faire les choses comme un spectateur.
Je n’en sais toujours rien. Mais le fait est là : j’étais devenu un criminel. J’avais laissé mon voisin atteint de la maladie d’Alzheimer et gravement allergique manger des cacahouètes et je l’avais regardé suffoquant, sans lever le plus petit doigt. J’aurais pu saisir le combiné, composer les deux chiffres du SAMU…
Mais je n’avais rien fait.
Je ne l’avais pas tué : je l’avais laissé mourir. Etait-ce si différent ?


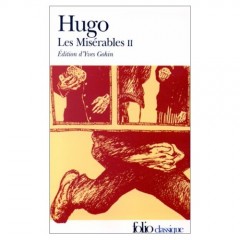 Les Misérables, Victor Hugo
Les Misérables, Victor Hugo Julien Gracq, La littérature à l'estomac :
Julien Gracq, La littérature à l'estomac :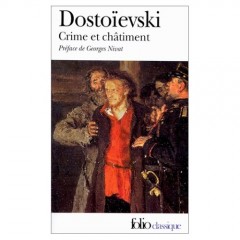 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.