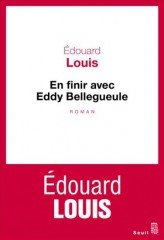 Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €
Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €
Livre 1
Picardie
(fin des années 1990 - début des années 2000)
Rencontre
De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n’ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître.
Dans le couloir sont apparus deux garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et l’autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché Prends ça dans ta gueule.
Le crachat s’est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l’odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons Regarde il en a plein la gueule ce fils de pute. Il s’écoule de mon œil jusqu’à mes lèvres, jusqu’à entrer dans ma bouche. Je n’ose pas l’essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d’un revers de manche. Il suffirait d’une fraction de seconde, d’un geste minuscule pour que le crachat n’entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas, de peur qu’ils se sentent offensés, de peur qu’ils s’énervent encore un peu plus.
Je n’imaginais pas qu’ils le feraient. La violence ne m’était pourtant pas étrangère, loin de là. J’avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d’autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d’insistance et mon père, sous l’emprise de l’alcool, qui fulminait Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça sale bâtard. Ma mère qui essayait de le calmer Calme-toi chéri, calme-toi mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c’était la règle, c’était ça aussi être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l’autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu’un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu’à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l’avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu’il extrayait pour en faire du boudin (le sang sur ses lèvres, son menton, son tee-shirt) C’est ça qu’est le meilleur, c’est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant quand mon père sectionnait sa trachée-artère étaient audibles dans tout le village.
J’avais dix ans. J’étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir je ne les connaissais pas. J’ignorais jusqu’à leur prénom, ce qui n’était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d’à peine deux cents élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j’ai d’abord pensé qu’ils venaient faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau ? La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde : les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers Nous les petits on intéresse personne, surtout pas les grands bourges.
Dans le couloir ils m’ont demandé qui j’étais, si c’était bien moi Bellegueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m’ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années,
C’est toi le pédé ?
En la prononçant ils l’avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L’impossibilité de m’en défaire. C’est la surprise qui m’a traversé, quand bien même ce n’était pas la première fois que l’on me disait une chose pareille. On ne s’habitue jamais à l’injure.
Un sentiment d’impuissance, de perte d’équilibre. J’ai souri – et le mot pédé qui résonnait, explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque.
J’étais maigre, ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible, presque nulle. À cet âge mes parents me surnommaient fréquemment Squelette et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller. Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l’on disait volontiers Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c’est une bonne maladie.
(L’année d’après, fatigué par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j’entrepris de grossir. J’achetais des paquets de chips à la sortie de l’école avec de l’argent que je demandais à ma tante – mes parents n’auraient pas pu m’en donner – et m’en gavais. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères – elle s’exaspérait : Ça va pas te boucher ton trou du cul –, je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage, comme ces insectes qui se déplacent en nuages et font disparaître des paysages entiers. Je pris une vingtaine de kilos en un an.)
Ils m’ont d’abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu’à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L’un m’a saisi les bras pendant que l’autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens : les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C’est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense – devant ce type de scène, je veux dire : avec un regard extérieur – à l’humiliation, à l’incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur.
Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J’ouvrais la bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l’oxygène, je gonflais la poitrine, mais l’air ne voulait pas entrer ; cette impression que mes poumons s’étaient soudainement remplis d’une sève compacte, de plomb. Je les sentais lourds tout à coup. Mon corps tremblait, semblait ne plus m’appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant qui s’affranchit de l’esprit, est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir. Le corps qui devient un fardeau.
Ils riaient quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d’oxygène (le naturel des classes populaires, la simplicité des gens de peu qui aiment rire, les bons vivants). Les larmes me montaient aux yeux, mécaniquement, ma vue se troublait comme c’est le cas lorsqu’on s’étouffe avec sa salive ou quelque nourriture. Ils ne savaient pas que c’était l’étouffement qui faisait couler mes larmes, ils s’imaginaient que je pleurais. Ils s’impatientaient.
J’ai senti leur haleine quand ils se sont approchés de moi, cette odeur de laitages pourris, d’animal mort. Les dents, comme les miennes, n’étaient probablement jamais lavées. Les mères du village ne tenaient pas beaucoup à l’hygiène dentaire de leurs enfants. Le dentiste coûtait trop cher et le manque d’argent finissait toujours par se transformer en choix. Les mères disaient De toute façon y a plus important dans la vie. Je paye encore actuellement d’atroces douleurs, de nuits sans sommeil, cette négligence de ma famille, de ma classe sociale, et j’entendrai des années plus tard, en arrivant à Paris, à l’École normale, des camarades me demander Mais pourquoi tes parents ne t’ont pas emmené chez un orthodontiste. Mes mensonges. Je leur répondrai que mes parents, des intellectuels un peu trop bohèmes, s’étaient tant souciés de ma formation littéraire qu’ils en avaient parfois négligé ma santé.
Dans le couloir le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence, toujours. Pédale, pédé, tantouse, enculé, tarlouze, pédale douce, baltringue, tapette (tapette à mouches), fiotte, tafiole, tanche, folasse, grosse tante, tata, ou l’homosexuel, le gay. Certaines fois nous nous croisions dans l’escalier bondé d’élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me frapper au vu de tous, ils n’étaient pas si stupides, ils auraient pu être renvoyés. Ils se contentaient d’une injure, juste pédé (ou autre chose). Personne n’y prenait garde autour mais tout le monde l’entendait. Je pense que tout le monde l’entendait puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d’autres dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d’entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas et chuchotait sur mon passage, que j’entendais Regarde, c’est Bellegueule, la pédale.

Le Seuil, 2014
Quatrième de couverture « Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza, très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici. »
En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre.
Édouard Louis a 21 ans. Il a déjà publié Pierre Bourdieu: l'insoumission en héritage (PUF, 2013). En finir avec Eddy Bellegueule est son premier roman.

http://www.youtube.com/watch?v=tWxMe7jvUOU.
http://www.franceculture.fr/emission-du-jour-au-lendemain-edouard-louis-2014-03-26.
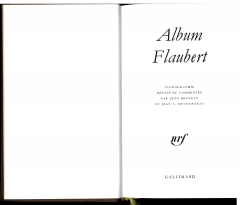

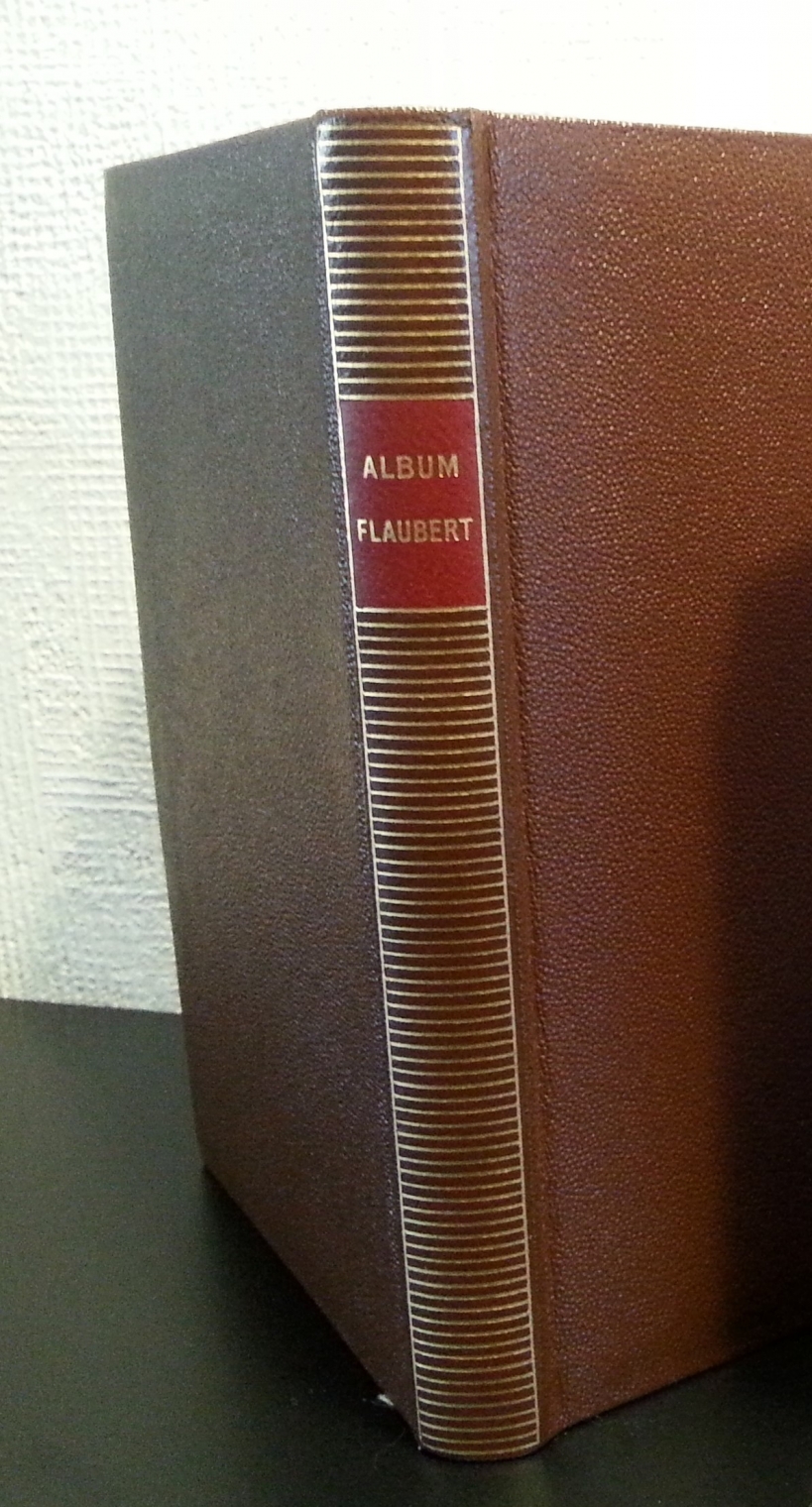
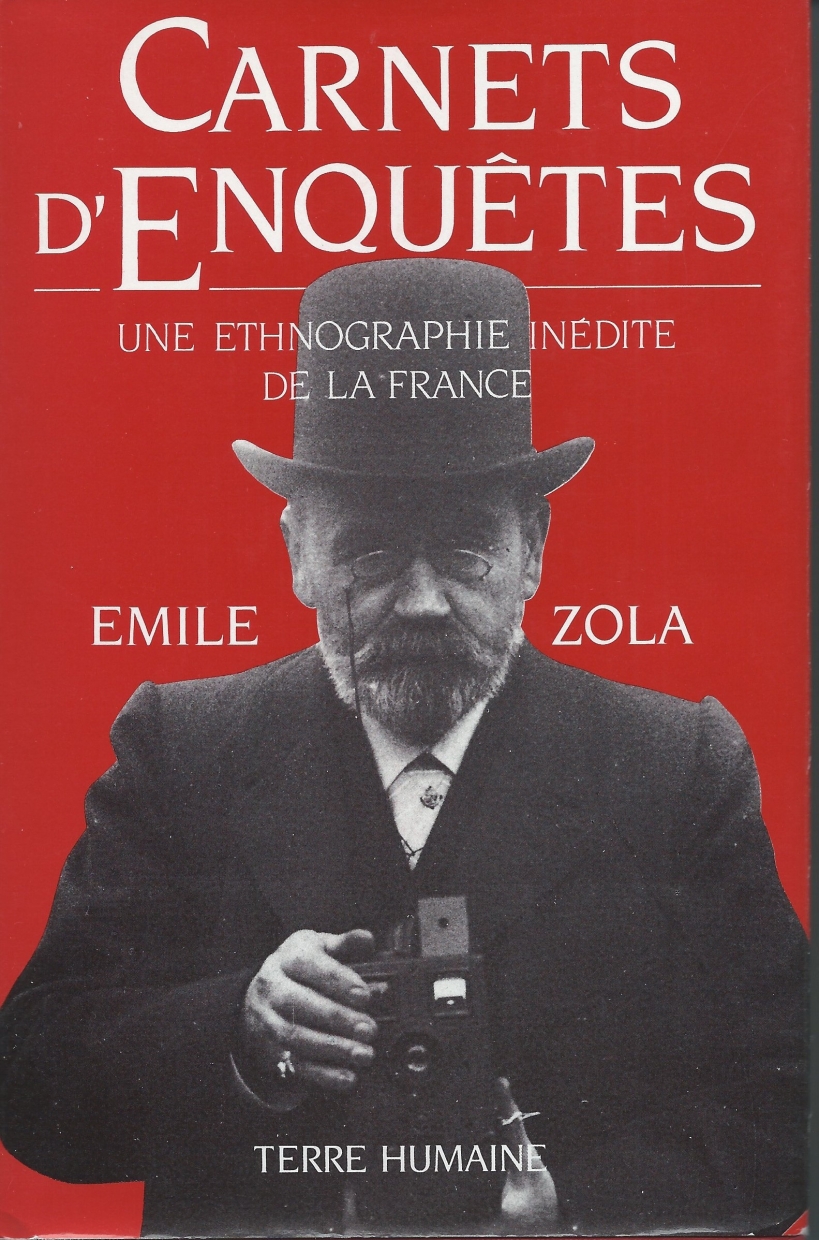
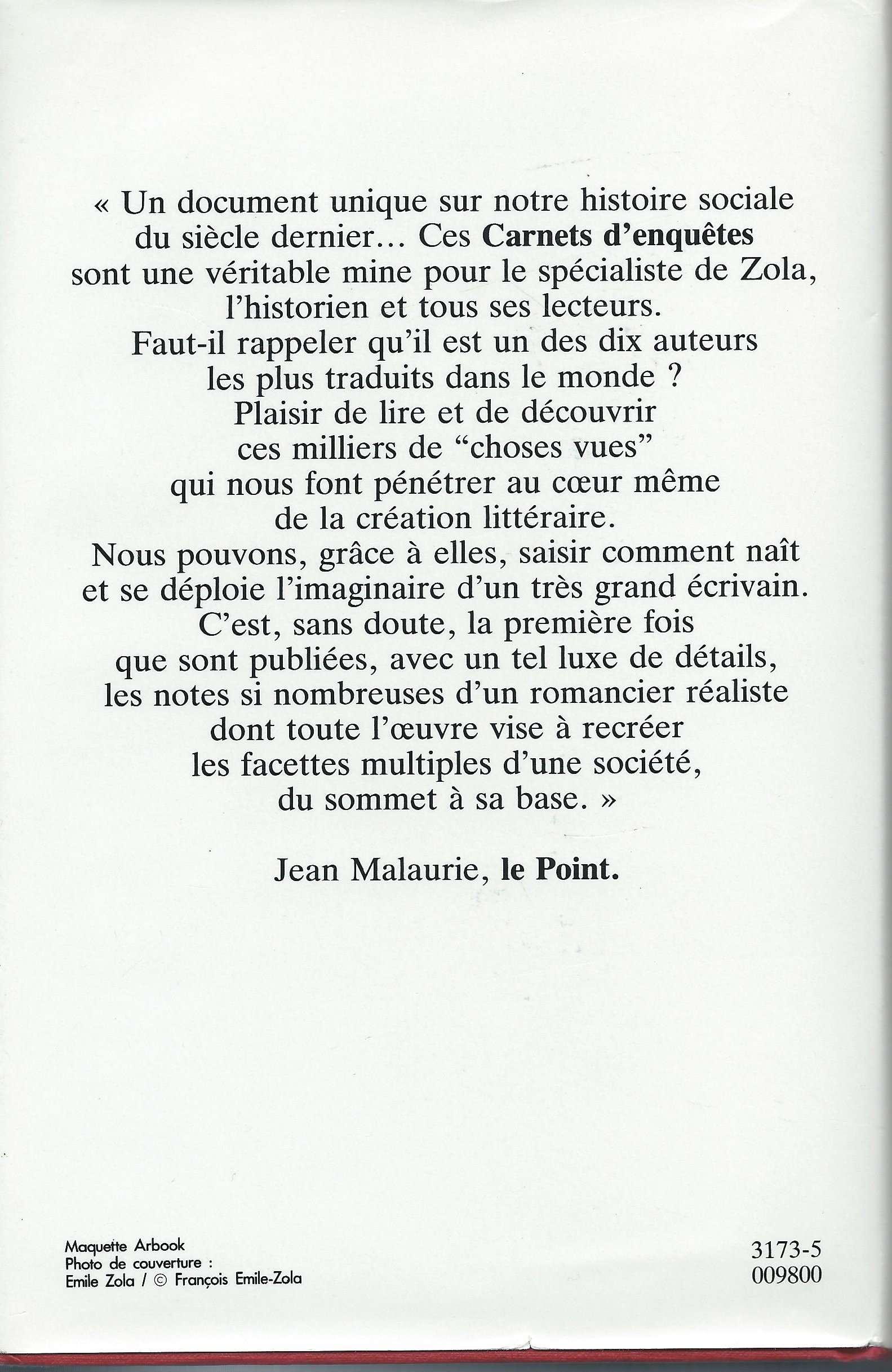
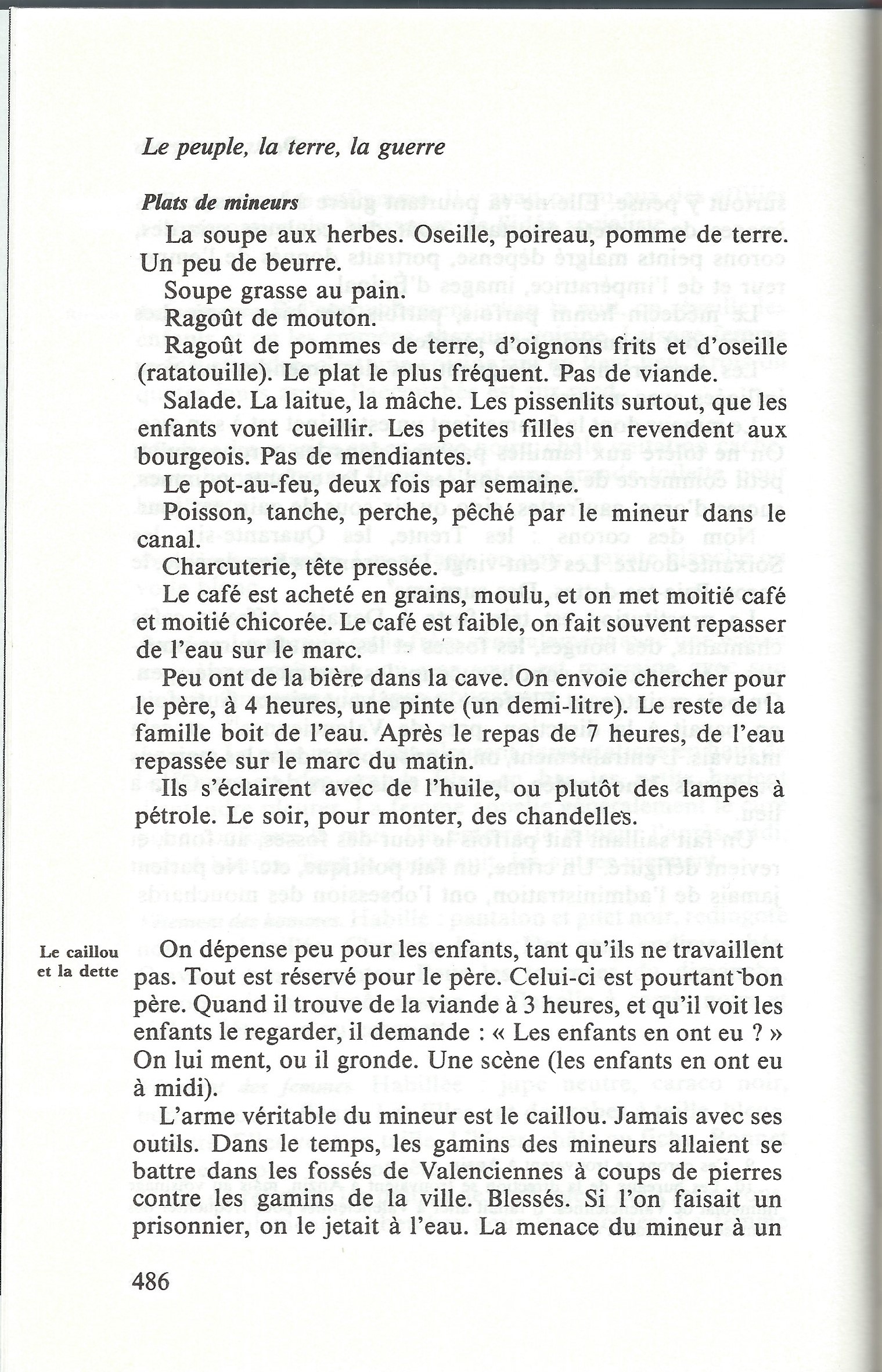
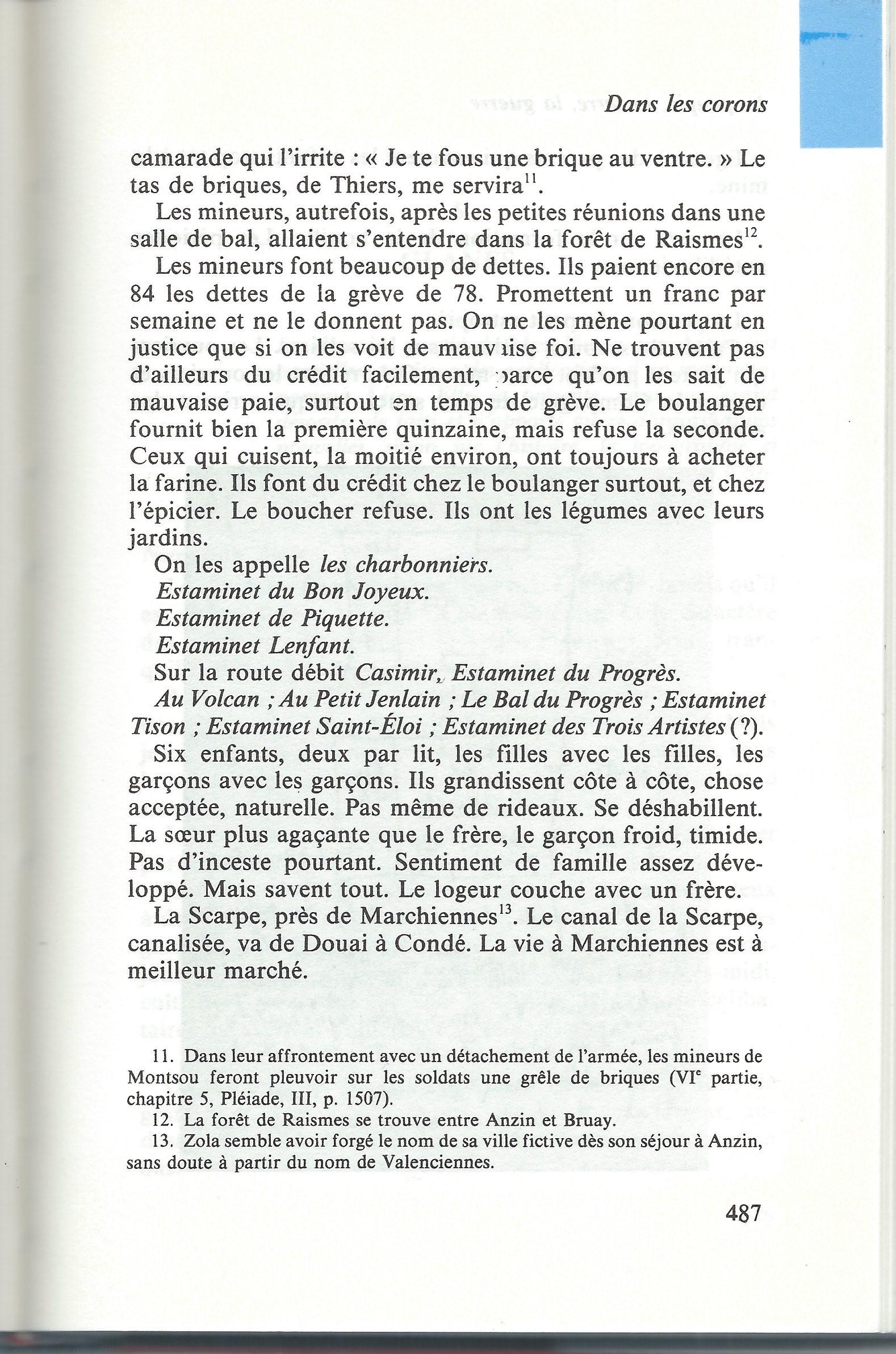
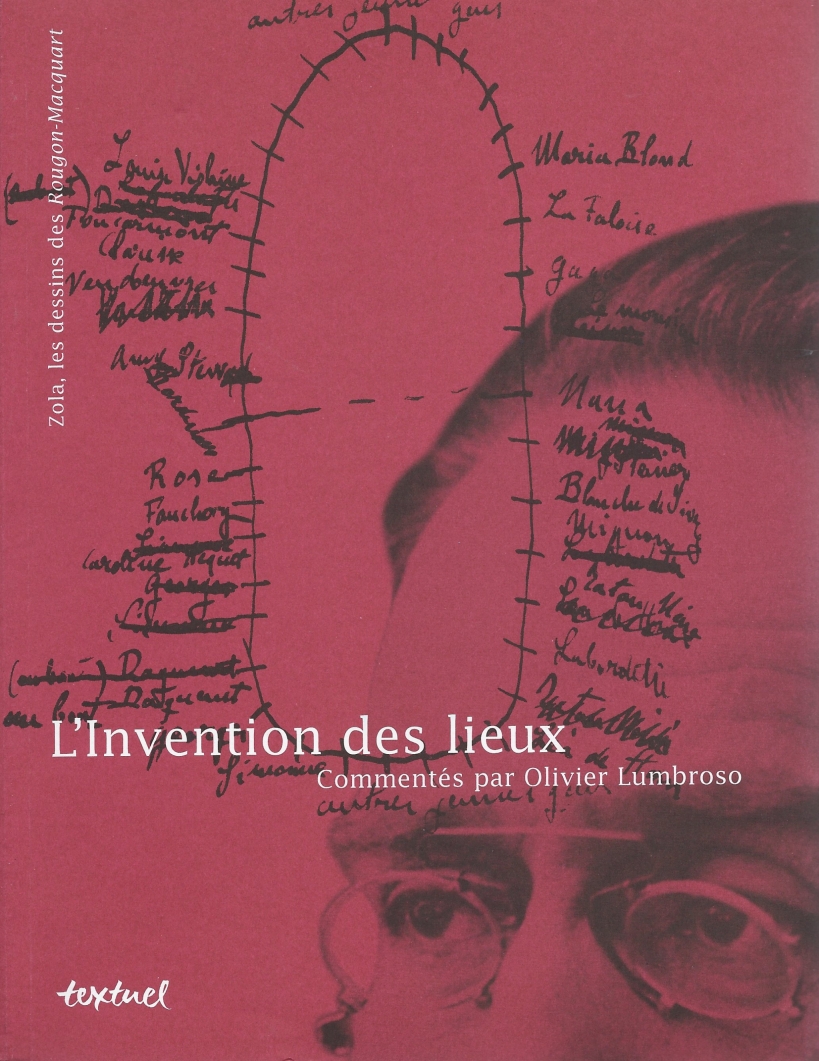
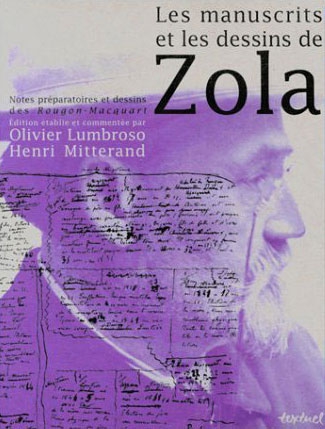

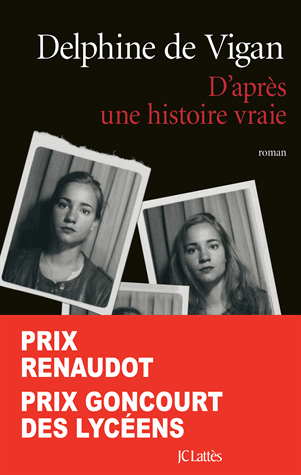
 Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.
Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.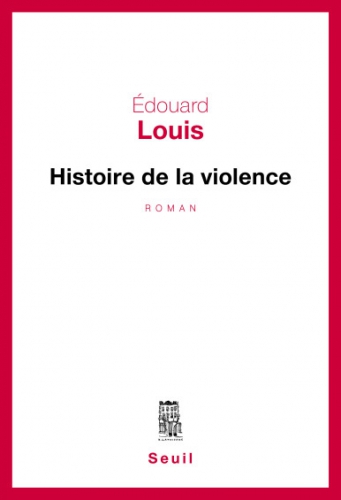
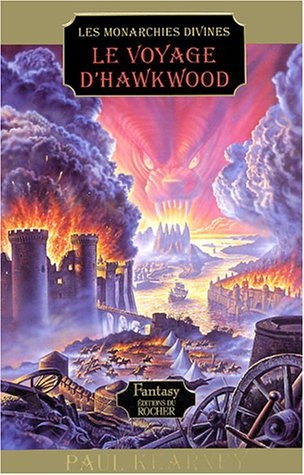
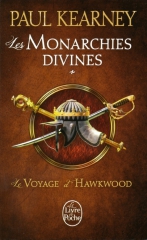


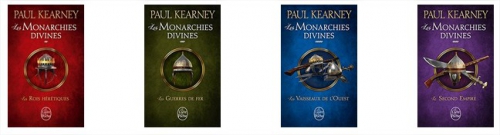


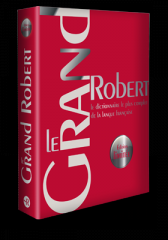
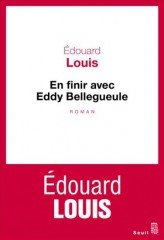 Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €
Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €

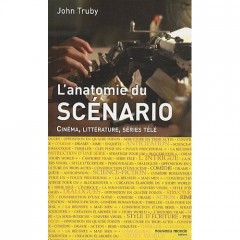

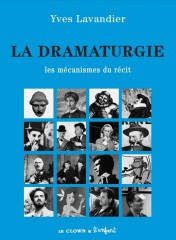
 Mon voyage est fini.
Mon voyage est fini. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.