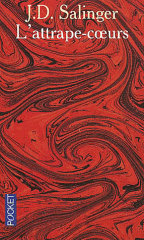 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander c'est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout ». J.D. Salinger, L'attrape-cœurs.
Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander c'est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. J'ai pas envie de vous débiter tous mes petits malheurs, mes petits chagrins de fils de bourge. « Y a toujours plus malheureux que soi. » ressassent à longueur de journée mes parents et pour une fois, ils ont fichtrement raison.
Mes parents, ils m'ont tout donné. Y avait qu'à claquer des doigts et hop ! J'avais tout ce que je voulais. Un petit chiot ? Clac ! Le panier d'osier prenait place dans la cuisine près du poêle en fonte. Une nouvelle raquette de tennis ? Clac ! La housse, un matin, noire et blanche, s'était lovée dans le canapé près de l'accoudoir élimé avec un petit ruban couleur or. Une nouvelle mob ? Clac ! J'entends encore mon père la démarrait dans la cour et le panache de fumée noire qui sortait du pot inox de la mob m'avait rendu fou de bonheur. Y avait qu'à demander et ça arrivait...
Non, je vais pas vous parler de tout ça. Ca n'a aucun intérêt et puis maintenant, j'en ai presque honte d'avoir été pourri ainsi. Je crois que ça m'a rendu con. A petit feu. Sans m'en rendre compte. Recevoir tout le temps sans jamais rien devoir, ce n'est pas bien. Ca vous apprend pas la vraie vie. Celle où vous recevez des baffes si vous vous bougez pas les fesses. Celle où vous prenez des torgnioles quand vous vous écartez du droit chemin.
Non, je vais plutôt vous raconter ma journée d'hier. Une journée comme il y en a pas tant et qui vous ouvre l'esprit mieux qu'un ouvre-boite. Je m'étais levé grincheux, comme à l'accoutumée et puis j'avais envoyé promené mes parents, comme toujours. Une journée ordinaire en somme. J'avais trainé avec ma bande, fumant trop, buvant trop, m'ennuyant et faisant toujours un peu les mêmes conneries. Le soir, avec les potes, on était sorti en boite et on avait pris ce qu'il fallait pour bien se vider la tête. Quelques litres d'alcool fort pour oublier tout ce qu'on aurait pu être et tout ce qu'on aurait pu faire, si on avait été un peu plus courageux.
Et maintenant, je suis dans cette petite cellule grise, terne, pourrie, qui sent l'urine et un tas d'autres trucs puants. Une cellule de dégrisement qu'ils appellent ça. Je me rappelle de presque rien. Je sais que je conduisais et qu'on s'est pris un arbre, après le petit bois. C'est con parce qu'à cet endroit-là, il n'y a rien, à part ce fichu arbre sur lequel la voiture est venue s'encastrer. Ce doit être un signe. Comme un avertissement pour que cet unique arbre à cent pas à la ronde, un hêtre je crois, ait fait un pas de côté en direction de la bagnole. Résultat, mon pote, celui qui était sur le siège passager est dans le coma. J'espère qu'il va s'en sortir et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir pris dix ans, d'un coup, comme ça et c'est au moins ce que m'aura apporté cette fichue journée. Voilà. Une journée de merde en apparence. Mais pour des cons comme moi, y a qu'une journée comme çà pour vous mette du plomb dans la tête. Et c'est à présent chose faite.



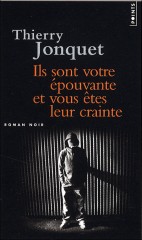 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.

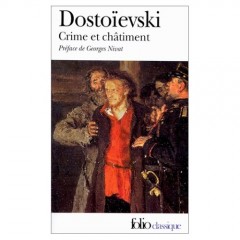 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. "Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
"Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." " "J'écris pour essayer de savoir qui je suis".
"J'écris pour essayer de savoir qui je suis".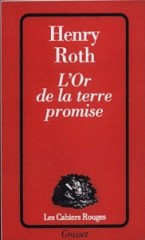 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.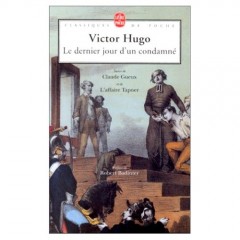 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.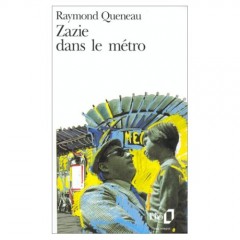 A partir de la première phrase d'un roman, et de toute la fin en gras, écrire une nouvelle.
A partir de la première phrase d'un roman, et de toute la fin en gras, écrire une nouvelle.
 Un extrait de Roméo et Juliette, Acte I, Scène V , de William Shakespeare
Un extrait de Roméo et Juliette, Acte I, Scène V , de William Shakespeare
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Le soleil commence à poindre et de ma place, je cligne des yeux pour ne pas être ébloui. Michel, qui s’est allongé un peu plus loin, se réveille aussi. Il m’engueule car il ne retrouve plus sa bouteille. Je l’entends maugréer, taper dans ses cartons et jurer comme un charretier. Je n’y prête même plus attention. D’ailleurs, tout m’indiffère.
Le soleil commence à poindre et de ma place, je cligne des yeux pour ne pas être ébloui. Michel, qui s’est allongé un peu plus loin, se réveille aussi. Il m’engueule car il ne retrouve plus sa bouteille. Je l’entends maugréer, taper dans ses cartons et jurer comme un charretier. Je n’y prête même plus attention. D’ailleurs, tout m’indiffère. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.