 "Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".
"Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".
John Maxwell Coetzee, Doubler le cap
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Olivier Leduc
 "Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".
"Nous écrivons parce que nous ne savons pas ce que nous voulons dire. Ecrire nous le révèle. L'écriture nous écrit, elle montre ou fabrique ce qu'était notre désir , un instant plus tôt".
John Maxwell Coetzee, Doubler le cap
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Nous roulions depuis une trentaine de kilomètres lorsqu’un couinement nous est parvenu depuis l’arrière » Philippe Ségur, Vacance au pays perdu.
Nous roulions depuis une trentaine de kilomètres lorsqu’un couinement nous est parvenu depuis l’arrière. Je regardai Marie qui fit la moue : j’étais aussi dubitatif qu’elle et n’accordai aucune importance à ce bruit étrange. Je continuai de rouler tout à fait normalement. Et je repensai même à ce que nous allions faire ensuite. Mon épouse s’était endimanchée, maquillée et parfumée plus que de raison pour cette occasion.
Le soleil ourlait une lumière orange vers l’ouest où nous nous dirigions avec la fourgonnette et où l’astre du jour commençait à décliner. Plus au nord, le ciel s’ennuageait un peu avec des cirrus qui semblaient s’étirer dans le ciel comme une volée d’oiseaux migrateurs. Je baissai le regard pour aborder le virage qui s’annonçait quand de nouveau un couinement retentit, un peu comme un grincement de porte.
Cette fois-ci nous n’avions pas rêvé. Pourtant tout s’était passé normalement pendant le chargement et nous avions fait ce qu’il fallait pour qu’il ne fasse pas de bruit. Nous l’avions bien attaché, solidement et nous avions tout fait pour que nous ne puissions pas l’entendre pendant le trajet. Qu’est ce qu’il pouvait bien faire à l’arrière de notre camionnette ?
Nous nous regardâmes, moi et mon épouse, ne sachant pas quoi faire. Je stoppai alors notre véhicule sur le côté, vérifiant que Manon, qui s’était lovée entre nous, dormait encore. Cela fait, je descendis, ouvrit la porte arrière le plus silencieusement possible, vérifiai qu’il était bien attaché, ce qui était le cas et qu’il ne pouvait pas se faire entendre.
Nous repartîmes le plus discrètement possible. Je ne roulai pas vite, ne voulant pas réveiller Manon. Quelques kilomètres plus tard, nous arrivions à la ferme.
Marie s’occupa de la petite, fatiguée par la route, qu’elle déposa dans le canapé. Je me chargeai du « colis ».
Et qu’elle fut la surprise de Manon, quand elle découvrit le paquet cadeau, déposé à ses pieds par nos soins sans avoir fait le moindre bruit.
Nous eûmes droit à un « Ho ! » de joie et des grands éclats de rire.
Bien des années plus tard, elle nous confia que cela avait été l’un de ses plus beaux anniversaires.
Elle s’appelait Espérance : onze kilos, le poil beige, un jolie Labrador femelle de six mois que nous avions été chercher au refuge. J’avais dû lui enfiler une méchante muselière pour ne pas que Manon l’entende !
Quant au couinement, c’était sans doute la caisse à outils métallique qu’Espérance avait déplacé avec ses pattes pendant le trajet.

La tante Germaine nous avait mis en garde de ne jamais utiliser cette vieille Underwood mais c’était juste avant son décès, une noyade, bête et inexplicable, dans sa baignoire en fonte et personne n’y prêta attention sachant que la tante Germaine sur la fin, n’avait plus toute sa tête.
Je finis, je ne sais plus comment, par récupérer entre autre cette machine à écrire et, ne voulant pas la jeter, elle se retrouva oubliée sous une couverture au grenier pendant de longues années.
Evidemment, on remplit son grenier, d’un tas de choses, souvent inutiles ou cassées, de babioles dont on aurait du se débarrasser et dont on ne se servira sans doute plus jamais. Tout cela dort, là-haut, au-dessus de nos têtes, dans un amoncellement de cartons et quand on finit par faire un peu de rangement, le grenier étant plein à craquer, on retrouve avec ravissement de vieilles bricoles qu’on prend presque pour des reliques.
J’avais, en triant, jeté beaucoup mais je ne pouvais me résoudre à me séparer de la vieille Underwood avec ses touches rondes et blanches, sa bouille prognathe, étalant son clavier comme les dents chez le dentiste, et son gros rouleau surplombant sa vieille carcasse. Plus je la regardais, plus elle semblait m’inviter à la descendre dans mon bureau, ce que je consentis à faire.
C’était puéril car je n’en avais aucune utilité. Cette pauvre machine des années 1920 ne supportait aucune comparaison face à mon PC assisté d'une imprimante laser.
Je disposai l’antédiluvienne machine dans un coin de mon bureau. Et une remarque de mon épouse ne se fit pas attendre :
— Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? me dit-elle.
— Une Underwood, lui répondis-je.
— Une Underwood. Et que comptes-tu en faire ? reprit-elle.
— Je n’en sais rien.
— Tu vas me faire le plaisir de t’en débarrasser.
Elle regarda la machine puis rajouta :
— Je ne l’aime pas cette machine. On dirait qu’elle me fixe.
Et je repris en lui demandant, comment elle pouvait ne pas aimer une machine à écrire, et comment une machine à écrire pouvait la fixer. Je mis tout cela sur le compte de la fatigue et elle s’énerva ; nous nous engueulâmes mais l’Underwood resta sur mon bureau. Le lendemain, je m’amusai même à taper dessus la liste des courses et surprise, le clavier fonctionnait à merveille ! J’avais auparavant retrouvé un vieux ruban dans un des tiroirs de mon secrétaire. L’après-midi, j’allai faire les courses à l’hypermarché, avec ma liste tapée avec la vieille machine et j’attendis une heure aux caisses : bug informatique. L’électronique n’est finalement pas aussi sûre qu’une bonne vieille mécanique…
Quelques jours plus tard, je me resservis de l’Underwood pour taper, pour le plaisir, le cours de français de Caroline. Je lui avais bien entendu demandé auparavant si je pouvais le faire… Et le lendemain soir, je l’attendais avec impatience, pour lui demander si je n’avais pas fait de fautes sur les deux feuillets que je lui avais tapés pour son cours. Elle avait une mine décomposée, les cheveux défaits, les yeux humides et m’expliqua, en sanglotant, que ça avait été les pires heures de cours de toute sa carrière et qu’elle ne comprenait pas ce qui avait littéralement déchaîné les collégiens à son encontre.
Je laissai de côté la machine à écrire, déçu. Il y eut les vacances de Pâques à la mer et l’Underwood sortit de mon esprit.
Je touchai de nouveau son clavier fin d’avril, pour taper une facture pour l’assistante maternelle que je déposai le soir même. Le lendemain, elle nous appelait, catastrophée de ne pas pouvoir garder notre bébé, elle était à l’hôpital, s’étant faite une luxation de la rotule du genou en revenant de la boite aux lettres.
Plusieurs semaines plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de Caroline, j’en profitai pour taper un petit mot doux avec la vieille machine à écrire de ma tante. Ce fut la dernière fois, que j’utilisai cette maudite machine. Evidemment, j’ai peine à croire qu’une machine puisse faire quoi que ce soit à notre encontre, qu’elle soit douée d’une capacité à faire le mal mais encore aujourd’hui, je repense à la mise en garde de ma tante Germaine et bien que je ne sois pas du tout superstitieux, j’ai des doutes.
Après avoir lu son petit mot et déballé son cadeau, Caroline s’est effondrée brutalement. Les médecins ont conclu à un AVC, c'est-à-dire une attaque cérébrale.
Cela fait maintenant un an, jour pour jour, qu’elle nous a quittés.
 La première phrase « C’était là qu’était dressée la table » est tirée du roman d’Elsa Triolet, Roses à crédit, 1959
La première phrase « C’était là qu’était dressée la table » est tirée du roman d’Elsa Triolet, Roses à crédit, 1959
C’était là qu’était dressée la table. Près d’un parterre de fleurs bariolées (j’imaginai que les graines du jardinier étaient tombées de sa poche trouée et j’en souris) et sous un vieux pommier qui en plus de nous faire de l’ombre, nous décochait régulièrement de petites pommes à cidre sur la tête ; ce qui apparemment exaspérait mon voisin de gauche, au teint pâle, taciturne et peu prolixe, qui non seulement ne profitait guère de l’ombre, étant mal placé sous une trouée de branches mais recevait beaucoup de projectiles ce que je ne pouvais expliquer.
Mon voisin de droite était plus bavard et parlait tellement, qu’il n’attendait même pas mes réponses pour passer du coq à l’âne, ou plutôt devrais-je dire du zizi au derrière car finalement tout tournait autour du sexe et toutes ses plaisanteries finissaient en propos graveleux. Je prenais ça avec philosophie, n’étant pas un fervent admirateur de ses blagues mais mon voisin de gauche soufflait bruyamment croyant pouvoir stopper la logorrhée du casse-pieds.
A côté de la grande table, qui consistait plus en l’assemblage un peu bancal de vieilles tables sur lesquelles on avait jeté une nappe immaculée, un chemin de gravillons menait à une grange, laide et ancienne. Ce petit chemin tortueux contournait un parterre de fraises des bois qui s’épanouissaient, les pieds dans l’eau, près d’une source qui affleurait à peine. Après le repas qui fut délicieux, réveillé par le café, et ragaillardi par la traditionnelle eau de vie, nous allâmes nous aérer l’esprit et je remarquai de loin que mon voisin de gauche, continuait de maugréer, s’étant trouvé un voisin de table qui semblait réceptif à son caractère grincheux. En s’approchant, la grange flanquée d’un appentis au-dessous duquel trônait fièrement de belles et grosses buches, offrait au regard un aspect plus flatteur : sa haute stature clouait les rais de lumière comme de vulgaires fils sur la toiture : une belle et agréable pénombre en résultait et une végétation verte et luxuriante s’était épanouie sur cette terre humide et accueillante. J’explorai un peu cette verdure constituée de haies touffues, d’arbustes et d’herbes folles autour de laquelle montaient d’agréables fragrances, comme des pétales de roses dans le vent, que j’humai avec plaisir puis je revins sur mes pas non sans jeter un dernier coup d’œil à cette grange. Odeur de bois humide, de feuilles, de terre, de plantes aromatiques peut-être, constituait un mélange subtil et enivrant qui resta présent encore un moment à mon esprit et seul mon voisin de gauche réussit à chasser cela, car en m’asseyant, je constatai qu’il renaudait toujours.
Je finis par m’assoupir, délicieusement réchauffé par la lumière du soleil qui commençait à poindre sur le côté du pommier, en me demandant comment pouvait-on être aussi être ronchon quand la nature nous offre, à portée de main, de petits trésors.

Il y a longtemps et dans de lointaines contrées, vivait une tribu en harmonie avec la terre, le ciel et l’eau. En ce temps-là, l’eau des rivières et des sources était limpide et l’on y pouvait boire sans risquer d’être malade. L’air était frais et pur, le sol était fertile et la terre offrait à ceux qui savaient la cultiver de beaux fruits et légumes. Evidemment, tout n’était pas idyllique. Parfois la mort venait frapper à la porte de la communauté, avec son lot de guerres et d’épidémies. Mais la vie y était le plus souvent paisible et agréable.
Dans cette ancestrale tribu, vivait un vieux sage que tout le monde respectait. Il savait ses jours comptés à cause de son grand âge mais il était serein car la vie lui avait apporté tout ce qu’il avait désiré : l’amour avec sa femme et ses cinq enfants, un toit à mettre au-dessus de sa tête, pour pouvoir l’abriter lui et les siens, de la pluie et du vent, de la neige et du soleil. Sa tente bariolée était d’ailleurs son seul bien. Il avait des amis fidèles sur lesquels il avait pu, tout au long de sa vie, compter. Il s’était très jeune passionné pour les choses de la nature : les animaux, et comment les chasser ou les apprivoiser, les plantes et leurs vertus médicinales, les nuages et comment prévoir le temps qu’il fera, les poissons et la pêche, la terre et comment la féconder avec des graines, le feu et la manière de le faire naitre, et c’est souvent qu’on venait lui demander conseil.
Aussi quand le vieux sage, à la barbe blanche et au dos vouté, fit des cauchemars noirs et étranges, toute la communauté s’inquiéta. Toutes les nuits, il hurlait, suait toute l’eau de son corps et prononçait d’inquiétantes paroles. Il semblait se tordre de douleur, se roulait par terre, se cognait, rampait comme le serpent, hurlait comme le chacal, bavait comme un loup. Certains soutinrent qu’il avait été envouté par l’esprit du malin, d’autres pensèrent à une mauvaise fièvre mais beaucoup, au fond de leur cœur, n’y croyaient pas. Ils avaient peur et redoutaient un grand malheur et invoquèrent les dieux pour leur miséricorde. Sa famille, ses enfants, car son épouse l’avait quitté en couche, étaient impuissants à le calmer et chaque nuit, ils lui donnaient un peu d’eau et le réconfortaient mais en vain, que si bien, une nuit sans lune, quand le loup hurle et le vent ne siffle pas, son cœur fut rappelé dans la prairie verdoyante où vont les âmes trop fatiguées par leur vie terrestre.
Les dieux furent convoqués, on chanta, dansa autour du feu et on appela les ancêtres. On fit offrande, on lui fit une sépulture et on organisa une belle cérémonie, pour calmer les cœurs et les esprits, et pour que l’âme du vieux sage parte en paix.
Bien des années plus tard, peu de gens se souvenaient de la triste fin du vieux sage quand d’étranges bonhommes surgirent sur la colline. Peu de gens se rappelèrent des mises en garde du vieux sage et de ses cauchemars inquiétants. Pourtant il les avait mis en garde sans le savoir face à un danger que personne n’aurait pu imaginer.
Dans ses rêves, il leur avait dit : « Ils viendront comme des nuées d’insectes. Ils seront pâles, méchants et bêtes. Ils ne respecteront rien : pas même la vie et la terre qui féconde, pas même l’eau qu’ils souilleront, pas même les arbres qu’ils coucheront comme le vent plie un brin d’herbe, pas même les animaux qu’ils extermineront. Facilement, vous pourrez les reconnaitre car ils auront tous un regard inquiet et triste. Toujours, ils courront après on ne sait quoi. Ils auront des armes en métal qui crachent le feu et sèmeront la mort ».

Je me réfugiai donc sous les escaliers, comme un chien apeuré dans sa niche. L’obscurité quasi-totale, l’éloignement des autres, là, je me sentais un peu apaisé. Mais la boule, celle qui nouait mes viscères, ne m’avait pas quittée. Et comme tous les novices, je me demandais bien qu’elle mouche m’avait piquée pour me retrouver ici, sous un escalier, à moitié tremblant, perlant de sueur, la bouche sèche et pâteuse, la gorge irritée comme une cheminée ramonée. Non, vraiment, je l’aurais bien crié, mais ça ne se fait pas : « Mais putain, qu’est-ce que je fous là !».
Ainsi c’était dit. Mais de nouveau, cela ne m’était d’aucun secours. Mes yeux commençaient à s’habituer à la pénombre, et je pouvais à présent contempler le travail architectural de ces travailleuses de l’ombre qui aiment à croquer les moustiques, l’amoncellement des décors, costumes, accessoires, oubliés dans les recoins de ces lieux comme des épaves éparpillées sur une grève rocailleuse. Je tournais nerveusement du mieux que je pouvais dans l’exigüité de cette pièce pour tenter vainement de transformer le désarroi de mon pauvre encéphale en échauffement musculaire : mais cela eut l’effet contraire. La panique s’exacerbait.
J’arrêtai, prenant ma tête entre les mains, croyant naïvement qu’elle allait exploser comme une grenade. Et là, quand je relâchai l’emprise de mes mains sur mes oreilles, l’horreur… Des chuchotements venaient de la salle
J’aurais voulu mourir sur le champ… Oui, d’un coup. Paf ! Et plus rien. Ou être subitement sourd, ou aveugle. Que l’on me transforme en blatte ou en limace. Que le plafond se fissure et s’effondre sur ma tête, que la foudre passe à travers les prises électriques et me grille, que le vent me démembre, que le soleil me liquéfie, que l’eau me fasse gonfler comme une éponge, que les sens me quittent, que la folie me prenne. J’aurais voulu toutes les catastrophes, toutes les morts, toutes les tortures mais pas celle-là…
Je suffoquais tellement que ma respiration s’accéléra outrageusement. Et après quelques minutes, il faut bien le dire, je réalisai que c’était une bénédiction. La respiration. Comment n’y avais-je pas pensé ? Se concentrer sur sa respiration.
Evidemment ce n’était pas la panacée mais cela avait le mérite d’atténuer les effets de monsieur chamboule tout sous la boite crânienne. Et me voici, à expirer, inspirer, comme un métronome lancé sur l’allegro. Quelques minutes de ce tempo oxygéné et me voilà, tout ragaillardi.
Le rideau se leva et j’en fis de même.
Les projecteurs inondèrent la scène et je montai sur le petit escalier menant à celle-ci.
Une dernière et longue hésitation, vite chassée par un bon coup au derrière et j’étais propulsé sur scène, aveuglé, pataud, tremblant, balbutiant, suant mon texte, les pieds de plomb, la machoire comme une enclume.
Mais très vite, les mots tels de petites fées bienveillantes, me soulevèrent de leurs petites ailes dorées, m’enivrèrent de leur douce chaleur maternelle, me rendirent courage et audace, force et confiance : la magie s’opérait.
Et comme il arrive souvent au théâtre, je brûlais les planches après les avoir fuis.
Mes jambes m’emmenèrent jusqu’au parking. Je marchai machinalement. Il y avait ce vent, déjà un peu frais pour la saison, qui cinglait mes joues. J’enfonçai mes mains dans mes poches, résigné. Le chemin, je l’avais empruntai des centaines de fois, des milliers sans doute: je ne mettais jamais amusé à faire le calcul. Mais, cinq fois par semaine, quarante-sept semaines par an, pendant vingt-cinq ans, cela doit bien faire des milliers de fois.
Je ne m’étais pas aperçu que je n’avais pas levé la tête depuis le bâtiment jusqu’à la voiture ; sans doute, avaient-ils déjà réussi à me faire croire que j’étais devenu un looser. Il y avait eu d’abord un e-mail. Glacial, impersonnel. Un style froid comme un bac à glaçons. Une appréhension m’avait envahie, un peu comme une idée vague au premier abord, mais qui sûrement devient plus précise à mesure que la matinée égrenait ses minutes à l’horloge fadasse du bureau. Je savais mais je ne voulais pas me faire à cette idée. Evidemment quand le pire vous arrive, vous ne voulez pas le digérer en une fois. Vous préférez que le morceau vous brûle l’œsophage, lentement, vous malmène l’estomac doucement et finisse par vous tordre les viscères tout aussi mollement. Une torture, en somme. Et quand mon chef m’appela dans son bureau, là mes minces espoirs volèrent en éclat comme une vitre que l’on brise. Je mettais toujours demandé comme je réagirai si la situation se présentait : hurlerai-je ? Serai-je grossier ? En fait, comme un boxer sonné, je ne pus réagir. Bouche-bée. Livide, le regardant pareil à un poisson rouge que l’on vient de foutre dans son petit bocal aux parois transparentes, que l’on vient d’introduire par la force dans ce qui va être, à présent, son univers. Et triste allait être le mien.
Je sortis machinalement les clefs de la Clio et je restai ainsi, les clefs dans le vide, le regard idiot, scrutant une brume qui s’épaississait devant moi, un avenir qui se troublait, floconneux.
Les heures passèrent. Je ne me rendis compte de rien mais je finis par démarrer. Je passai tout de même les vitesses et la voiture me conduisit jusque devant chez moi, où elle se gara. Je descendis, monta les marches et poussa la porte, la tête bouillonnante, les jambes marshmallow, le cœur lacéré. Qu’est-ce que j’allais bien pourvoir dire aux enfants et à Lucie ?
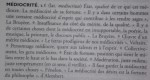 La médiocrité. Ce mot, ces quatre syllabes, me font l’idée du tranchant de la guillotine entamant la chair du pauvre supplicié. Ces syllabes tintent dans ma tête. Méchamment.
La médiocrité. Ce mot, ces quatre syllabes, me font l’idée du tranchant de la guillotine entamant la chair du pauvre supplicié. Ces syllabes tintent dans ma tête. Méchamment.
Médiocrité. Cette ritournelle me donne la nausée. Pareil à une drogue que vous savez pertinemment nocive mais que vous vous évertuez à distiller dans votre corps, au goutte à goutte, chaque jour, sans jamais pouvoir vous arrêter. Voilà, c’est ma drogue, ma médiocrité. Je la cultive comme un bon jardinier qui regarde ses fruits croître et s’épanouir. Plus je la regarde en face, sans sourciller, plus elle m’est familière. Mais je crois que c’est une chose terrible pour quelqu’un comme moi, la médiocrité. Car elle me ronge, doucement, pernicieusement mais certainement. Elle me ronge de l’intérieur, tel un parasite, me rabaissant, me dévalorisant, toujours un peu plus chaque jour.
Comme si on m’avait forcé à faire ça, à coucher sur le papier tous ces mots, à tourner sans relâche les pages du dictionnaire, à vouloir à tout prix finir un roman ou une nouvelle. Me donner des armes puis me les enlever en me faisant bien comprendre que ce n’est finalement pas pour moi. « Stop, fini. Fin de l’histoire, t’est trop mauvais, va voir ailleurs, mon petit gars, c’est pas pour toi. La littérature, faut la laisser à des gens dont c’est le métier ».
Finalement je suis assez intelligent pour avoir envie d’écrire, suffisamment intelligent pour me rendre compte de ma médiocrité et trop peu intelligent pour écrire des choses intéressantes : voilà tout est dit.
J’en viens même à envier ceux qui n’ont pas de dessein. Ça doit être si simple, se lever, faire un peu de bricolage, un peu de sport, se lover dans son canapé, une couverture jetée sur ses épaules et regarder la télévision en toute simplicité et ne pas se poser de questions existentielles. Profiter du moment présent et ne pas se poser de questions. Voilà cela doit être la solution et je ne sais pas si comme Einstein, si c’était à refaire, je deviendrai plombier mais sans cesse, la question me vint à l’esprit.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Paul Nizan, Aden Arabie : "J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie".

J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. Ce n’était pas tant ma situation matérielle qui m’oppressait, bien qu’elle n’était pas enviable. C’était plutôt un sentiment, un mal-être même, qui se distillait sournoisement dans mes veines encore jeunes, m’obscurcissant l’avenir et l’esprit mieux que le malheur. Tous les chemins, même les plus sinueux, m’étaient offerts et j’aurais du en être satisfait. Mais cette liberté, ces multiples possibilités, ces hasards de la vie qui allaient frapper à ma porte, m’inquiétaient, m’oppressaient plutôt qu’ils me rassuraient. Cela parait absurde maintenant mais mon caractère est sans doute responsable de mon dégoût pour cette période de la vie.
Les autres m’apparaissaient comme des étrangers. Moi-même avec des boutons blancs et rouges qui mouchetaient ma face, je ne me reconnaissais plus : mon corps dégingandé, gauche et boutonneux et qui m’échappait, m’était étranger. Comment aurais-je pu faire un pas vers une femme, séduire, plaire alors que moi-même, je me dégoutais presque.
Et plus je me claquemurais, plus toute cette merde me remontait à la gueule. Les jours passaient, s’étiraient en de longs et ennuyants chapelets d’heures que je tentais de garnir par d’inutiles futilités : acheter un morceau de foie de porc, me balader sur la digue, solutionner ou plutôt ne pas parvenir à résoudre un problème de mathématiques, me tartiner de crème anti-acnéique…
Les week-ends, je les exécrais. Je préférais encore la semaine où j’avais l’illusion que mon emploi du temps d’étudiant remplissait ma vie : il y avait des colles, des cours, des TP pour m’empêcher de respirer les miasmes de mon existence. La fin de semaine, c’était autre chose : il n’y avait rien. Jamais rien de prévu. Comme tout m’était offert, je ne faisais rien, ou presque rien. Et cela dura plusieurs années avant que je rencontre à la bibliothèque l’improbable : Crime et châtiment à la main, un sourire au coin des lèvres, elle passa sa main dans sa longue chevelure et tout changea :
J’étais encore un enfant, elle me fit homme.