 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Daniel pennac, Comme un roman : "Le verbe lire ne supporte pas l'impératif".
Le verbe lire ne supporte pas l’impératif. Elle avait beau nous le répéter « Lisez !», « Mais lisez donc ! Que diable !». Son martèlement pédagogique, ses intimidations d’un autre âge n’y faisaient rien. Les trente têtes de la 3ème1 ployaient un peu dans la petite salle de classe du préfabriqué mais elle pouvait toujours causer, notre prof de français, 380 grammes de Stendhal, La Chartreuse de Parme, Folio, 700 pages, écrit en petit caractère ne pesait pas bien lourd face au vélo, roller, sarbacane et console Atari.
Rien qu’à le prendre entre les pognes, on en avait le vertige : comment un gars, de son vrai nom Henri Beyle, pouvait avoir écrit un pavé pareil ? C’était incompréhensible pour notre pauvre cervelle d’ado. Et le plus extraordinaire est que des gens avaient non seulement lu tout le bouquin mais en plus, l’avaient apprécié ! Là, ça nous en bouchait un coin. De l’admiration pour cette Béatrice Didier ! Elle avait même écrit dans cette Postface qu’elle avait eu une « joie inaltérable ». Et sur la quatrième de couverture, on pouvait lire de Balzac : « M.Beyle a fait un livre où le sublime éclate de chapitre en chapitre ». Pourtant c’est peu dire si on avait essayé moi et Pascal, y avait rien à faire, c’était indigeste, comme de la choucroute froide.
Le début par exemple : « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d’apprendre au monde qu’après tant de siècles César et Alexandre avaient un successeur ». Le début d’un roman ne devrait pas être écrit pour allécher le lecteur ? Nous étions sceptiques.
Evidemment nous avions un plan de lecture : pour ingurgiter les 554 pages du roman, il fallait qu’on nous découpe l’effort, qu’on le tronçonne à la manière d’un rosbif bien saignant, le débitant en minces tranches plus facilement digestes. J’avais donc suivi ce régime forcé mais en l’adaptant quelque peu.
J’avais lu l’essentiel, la préface, l’avertissement, la postface, le dossier : la vie de Stendhal, les sources, l’article de Balzac et les passages recomposés par Stendhal et enfin les notes. Pour ce qui est du roman lui-même, le découpage professoral avait été un peu malmené. J’avais bien tenté de me laisser emporter par la vague Stendhalienne mais ces soirs-là, blotti dans mon lit rustique, la tête calée par un gros oreiller mou, à la lumière pâle de la lampe, la déferlante s’était transformée en vaguelette me laissant penaud sur la grève, les paupières lourdes, happées par la gravité, avides de se fermer pour de bon, comme l’épais folio gisant sur le matelas. Les lignes dansaient devant mes yeux, un épais brouillard et je lisais mécaniquement, sans plaisir, les mots succédant aux mots, pour finir en bas de la page à me rendre compte que j’avais perdu le fil de l’histoire. Alors je recommençai, revenant en arrière et il y avait ce bruit angoissant de la pendule posée sur la table de nuit égrenant les secondes ; je n’avançai guère. Un fiasco. Il me restait tant à lire et il fallait bien dormir alors j’élaguais, je tronçonnais des paragraphes puis des pages entières et pour finir, honteux, je sautais des chapitres dans leur intégralité.
En classe, le résultat ne se fit pas attendre. Première interrogation, un désastre…
Alors il y eut une bouée de sauvetage : lecture en diagonale comme pour mieux se prouver à soi même qu’on est quand même capable de lire, en partie, ce foutu bouquin avec un renfort mince et rouge mais de taille : le Profil. Le fameux Profil. Rassurant avec son résumé qui nous fait croire que sa possession nous dispense de lire ce fichu bouquin.
Avec ce livre svelte, tout est plus simple, Fabrice del Dongo nous apparaitrait presque sympathique. L’histoire, enfin, on la découvre et si vite en plus. Comme un voleur qui se serait escrimé à entrer dans une demeure, tentant de fracturer une porte ici, essayant de se faufiler à travers une lucarne là, et finissant par découvrir les clefs de la maison dans une jardinière.
Voilà j’avais les clefs du bouquin. Enfin je croyais les avoir. Une illusion. Car les interrogations qui suivirent se révélèrent aussi catastrophiques.
A l’époque, je ne compris pas pourquoi.
Maintenant je sais.
Je sais que le verbe lire ne supporte pas l’impératif.
Et quand il n’y a pas de plaisir dans la lecture mieux vaut tout arrêter. Et ce n’est pas un résumé qui peut pallier la lecture d’un ouvrage car l’histoire n’est pas tout, il y a les personnages, le style, les dialogues… tout ce qui fait la vie d’un roman.
Alors j’aurais aimé avoir lu, à l’époque, le livre de Daniel Pennac, Comme un roman. Car j’aurais pu répondre à ma jeune professeur de lettres et de latin, que je faisais mienne « les droits imprescriptibles du lecteur » de Pennac en particulier, les numéros 1 et 3.
Le numéro 2 (« le droit de sauter des pages ») sans le savoir, j’en avais abusé.
« 1. Le droit de ne pas lire
3. Le droit de ne pas finir un livre ».
 Quatrième de couverture, Folio poche, Exercices de style, Raymond Queneau :
Quatrième de couverture, Folio poche, Exercices de style, Raymond Queneau :


 .
. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.  Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. "Tassée sur sa butte, la laide église décapitée soulevait lourdement ses épaules veuves au-dessus du paysage fuligineux."
"Tassée sur sa butte, la laide église décapitée soulevait lourdement ses épaules veuves au-dessus du paysage fuligineux." "Une espèce d'hurluberlu long comme une perche à houblon, noir comme un bâton de réglisse, fendu d'un sourire à faire rêver un fabricant de pâte dentifrice."
"Une espèce d'hurluberlu long comme une perche à houblon, noir comme un bâton de réglisse, fendu d'un sourire à faire rêver un fabricant de pâte dentifrice." Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. 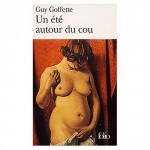 Les six premières phrases du roman de Guy Goffette : Un été autour du cou
Les six premières phrases du roman de Guy Goffette : Un été autour du cou "La 2 CV est une boîte cranienne de type primate : orifices oculaires du parebrise, nasal du radiateur, visière orbitaire des pare-solei, mâchoire prognathe du moteur, légère convexité pariétale du toit, rien n'y manque, pas même la protubérance cérébelleuse du coffre arrière."
"La 2 CV est une boîte cranienne de type primate : orifices oculaires du parebrise, nasal du radiateur, visière orbitaire des pare-solei, mâchoire prognathe du moteur, légère convexité pariétale du toit, rien n'y manque, pas même la protubérance cérébelleuse du coffre arrière." Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
 "Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le coeur. Les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre, et que j'y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien.
"Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le coeur. Les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre, et que j'y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien.
