Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.
« Lorsque l’Enquêteur sortit de la gare, il fut accueilli par une pluie fine mêlée de neige fondue. », L’Enquête,  Philippe Claudel.
Philippe Claudel.
Lorsque l’Enquêteur sortit de la gare, il fut accueilli par une pluie fine mêlée de neige fondue. Il fit alors un geste pour se couvrir la tête mais sa main resta comme suspendue derrière sa nuque, ses doigts gigotant autour du col de son duffel-coat à la recherche d’une hypothétique capuche qu’il ne trouvait pas. Il s’arrêta sous la lumière pâle et orangée d’un lampadaire. La rue était étrangement calme pour un vendredi soir : aucun passant à gauche ni à droite. On entendait au loin qu’un vague et étouffé cliquetis qui semblait provenir des alentours de la gare : certainement une rame qui venait de s’ébranler et qui tirée par une de ces locomotives diesel noire et joufflue partait en direction de L., pensa-t-il.
Puis il reprit son chemin. La pluie avait cessé de tomber mais pas la neige qui à présent floconnait plus drue glaçant les trottoirs d’une couche délicate et évanescente. L’enquêteur marchait machinalement, l’esprit embrouillé. Il passa la main dans ses cheveux humides et il ne comprenait toujours pas pourquoi son duffel-coat n’avait pas sa capuche. Perdait-il la tête ? Il se le demandait et il finit par se convaincre que sa veste n’avait jamais eu de capuche quand il tourna à l’angle de la rue A. et du boulevard P.
Quand il arriva en bas de chez lui, la neige formait alors une couche de plus de cinq centimètres sur le sol. Il fit le code à quatre chiffres. Rien ne se produisit. Il le refit. Rien. Il le fit à nouveau. Toujours rien.
Il souffla, posa son sac en toile sur les marches et prit son portable pour appeler la concierge Mme V.
Evidemment, elle ne répondit pas. Il pensa un instant crier mais à l’idée que l’immeuble verrait ses fenêtres s’illuminaient, et que des têtes renfrognées aux paupières endormies se pencheraient sur lui, l’examineraient méchamment afin de savoir qui était le malotru capable de les réveiller à une heure si tardive, il abandonna cette idée.
Il sonna alors au hasard à l’interphone car il ne pouvait pas décemment sonner chez la concierge au risque de réveiller son canari cardiaque, la sonnette de tous les appartements étant des plus assourdissantes. Un canari cardiaque, cela lui apparut subitement ridicule et il ne se souvenait plus qui lui avait dit cela, la concierge ? Un voisin ?
Un coup, deux coups, trois coups… puis un grésillement suivi d’un long silence. Il parla. On l’écouta. Et de nouveau un long silence troublant. A la place de lui ouvrir la lourde porte en inox gris, on lui raccrocha au nez.
Durant les trois ou quatre heures qui suivirent, il sonna à tous les boutons qui mouchetaient la petite grille rectangulaire de l’interphone ayant le loisir de découvrir, hormis le sien, les noms de tous les voisins qui habitaient son immeuble, certains qu’il ne connaissait ni de vue, ni de nom, d’autres qu’il croisait régulièrement et qu’il saluait aimablement d’un bonjour Monsieur ou d’un bonjour Madame et dont le plus souvent il ignorait le patronyme. Personne ne lui répondit. Personne ne lui ouvrit et ce n’est qu’aux premières lueurs du jour, quand la ville endormie et emmitouflée dans un manteau de neige s’apprêtait à se réveiller, que la porte s’ouvrit sans trop qu’il ne sache comment. Sur le coup, il sursauta et grelottant, les muscles raides comme des piquets de tente, il eut toutes les peines à franchir les quelques dizaines de centimètres qui le séparaient du hall chauffé. Quand ce fut chose faite, serrant son sac en toile humide sur sa poitrine, il appela l’ascenseur et il lui sembla alors que celui-ci descendait avec une lenteur extrême. La porte finit pas s’ouvrir et il s’engouffra dans la cabine. Il appuya sur le numéro cinq, la porte se fermait au moment où une jambe interrompit le processus. Une personne essoufflée entra. Un grand homme au visage banal et sévère, au costume sombre dont les manches étaient élimées, le salua. L’homme n’appuya pas sur les boutons de l’ascenseur. Désirant être aimable, il engagea la conversation et s’étonna des tremblements de l’Enquêteur. L’Enquêteur le remercia et lui répondit de ne pas s’inquiéter davantage et qu’un désagrément était responsable de son triste état. L’homme ne dit alors plus rien et quand l’ascenseur atteignit le dernier étage, il quitta la cabine si précipitamment que l’Enquêteur intrigué et désirant savoir où il logeait, n’eut pas le temps d’apercevoir la porte de son appartement qui claqua dans le vide. Ses pas lourds et fatigués le menèrent devant sa porte et il allait introduire la clef dans le canon en laiton quand il suspendit son geste.
Le numéro 57 en lettres dorées lui faisait face, il lâcha alors son petit sac en toile qui rebondit mollement sur le paillasson orange qu’il ne reconnut pas. Des bruits venaient de l’appartement, une musique étouffée dont la mélodie lui rappelait l’écriture subtile et délicate d’un concerto pour piano de Mozart, couverte par ce qui lui semblait être un poste de télévision. Il ne se hasarda pas à introduire la clef et complètement désappointé, cherchant du regard les autres numéros du couloir, il allait partir quand un homme ouvrit violement la porte de l’appartement 57 et lui dit :
— Que voulez-vous ?
— Je… dit-il et il ne parvint pas à articuler la suite tant son cerveau s’était arrêté de fonctionner à la manière d’un cœur qu’on prive de sang ou d’un appareil électroménager qu’on débranche du secteur.
L’homme de l’appartement 57 regardait l’Enquêteur et le prit pour un sans-logis à la vue de l’état de ses vêtements. Il lui dit alors :
— Qui vous a ouvert ?
— Je ne sais pas, lui répondit l’Enquêteur toujours aussi grelottant dans ses habits humides.
L’homme lui mit alors une pièce dans la main et lui dit :
— Je vais vous raccompagner.
— Me raccompagner ?
— La concierge ne doit pas vous voir, lui dit-il en souriant.
Elle appellerait la police.
— Mais je ne suis pas un SDF. Vous vous méprenez.
— Oui, oui, bien sûr. Qu’est-ce que vous faisiez là, devant ma porte ? Vous alliez sonner et me demander une petite pièce ?
— Non.
Il le prit par le bras et l’entraîna presque paternellement vers l’ascenseur.
— Ne vous inquiétez pas, je vous raccompagne.
— Mais vous ne comprenez pas.
Il appela l’ascenseur qui n’avait pas bougé d’un pouce : les portes s’ouvrirent.
— Vous ne comprenez pas, je rentrai chez moi.
— Pardon, lui dit l’homme. Chez vous ?
— Oui, chez moi.
— Je ne vous connais pas.
— J’habite ici… je veux dire, à cet étage… au numéro 58.
— Parbleu, il n’y a pas de numéro 58 ici ! Qu’est-ce que vous me racontez là !
— Attendez… J’habite ici… Regardez la clef de mon appartement.
L’homme l’examina attentivement tandis que les portes de l’ascenseur se refermèrent doucement.
— Oui, c’est bien le même modèle de clef… une Tesa, mais qu’est-ce que ça prouve ? Vous l’avez sans doute trouvé dans la rue, ou volé ou je ne sais quoi…
— Non, j’habite ici. Comment dois-je vous le dire ?
— Ecoutez, je ne comprends rien et vous me fatiguez à présent. Je connais tous mes voisins depuis plus de cinq ans et vous n’en faites pas partie et il n’y a pas d’appartement 58 ni au 5ème, ni au 4ème, ni à aucun autre étage de notre résidence.
La porte s’ouvrit à présent et l’homme du trainer l’Enquêteur qui s’était affalé et pleurait doucement comme un enfant apeuré, recroquevillé telle une bête aculée, désespérée, vidée et soûle de tout ce qui lui arrivait. Il ne comprenait plus rien. Tout s’effondrait comme un château de cartes qu’une main sadique et folle s’évertuait à balayer d’un revers et sa vie d’Enquêteur si prévisible avant semblait se dérégler à présent d’une manière si incompréhensible qu’il doutait même que ce qu’il lui arrivait était réel. N’était-ce pas un absurde cauchemar ? N’allait-il pas se réveiller tranquillement avec à ses côtés, au bout de son lit, son fidèle chat qui ronronnerait comme à l’accoutumée.
Il ouvrit les yeux. Il passa sa main sur ses joues humides et s’aperçut qu’il était de l’autre côté de la vitre. Tout était à recommencer.
Il regarda les marches et la neige qui y affleurait. Il tourna la tête et vit le long tapis immaculé parsemé de cristaux de glace.
Aucune trace. Aucun pas aux alentours. La ville devait bien se réveiller, pensa-t-il.
Il se leva machinalement, tapota ses mains pour se les réchauffer et s’aperçut qu’il n’avait plus son sac en toile. Il fit un tour sur lui-même, regarda à ses pieds, près de la porte, dans le hall en collant sa tête près du double vitrage de la porte. Rien. Seulement la buée qui faisait une tache grasse et ovale sur le carreau. Le sac avait du tomber tout à l’heure.
Il s’assit ou plutôt se laissa glissé complètement las, totalement vidé de toute énergie. Les minutes défilèrent et il semblait prostré, sans réaction aucune. Dans la rue, à l’image de son esprit qui s’était ennuagé d’un brouillard cotonneux et lourd de résignation, de lassitude et d’incompréhension, rien ne se produisait. Pas une auto ne roulait sur la chaussée vierge, pas un passant ne foulait de ses pieds cette neige promettant d’être craquante sous la semelle, pas un oiseau ne fendait l’air étonnamment clair et limpide. Il n’y avait que le souffle de l’Enquêteur qui butait contre une montagne d’indifférence.
En fin de matinée, toujours un peu plus transi de froid, il esquissa quelque geste gauche, inutile et vain.
Puis il se replongea dans une espèce de rêverie où l’esprit vagabonde dans les prairies vertes du passé. Il resta ainsi dans cette quasi extase économisant ses gestes comme un avare ses sous, recroquevillé, le dos appuyé sur un des murs de son immeuble.
Le soir, par un miracle qu’il ne comprit pas, la porte s’ouvrit et ses jambes l’entraînèrent dans le hall, dans l’ascenseur et au cinquième étage. De nouveau, il ne trouva pas l’appartement 58 et un des résidents le refoula hors de l’immeuble. Cela se reproduisit le lendemain puis le surlendemain.
Et à l’heure où j’écris ces quelques lignes, je puis vous assurer que l’Enquêteur est toujours assis en bas de son immeuble et ce soir, la porte s’ouvrira, il marchera difficilement dans le hall comme si chacun de ses pas allait être le dernier, il s’engouffrera dans la cabine qui l’entrainera jusqu’au cinquième étage et là, pour une raison qui reste inexplicable, la porte vernie de son appartement, celle-là même que sa main poussa de si nombreuses fois, ne se trouvera plus à sa place.

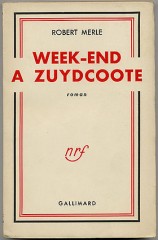 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman (l’incipit), écrire une nouvelle.
 La nuit ne communique pas avec le jour. Elle y brûle. On la porte au bûcher à l’aube. Et tous les spectres qui ont bu jusqu’à l’ivresse et qui se noient dans ses bras à peine soutenus par des lumières criardes et stroboscopiques, soulés par ce trop-plein de musique insupportable, sortent et brûlent leurs ailes à la lumière du jour. A peine quelques pas dehors, vacillant, cherchant leurs clefs dans leurs poches sans fond, ils se retournent sur celle qu’ils ont ramassé sur une piste trop clinquante et là, ils doutent déjà. Ils doutent d’avoir été avec cette fille qui à présent, en pleine lumière, se traîne sur le macadam sale.
La nuit ne communique pas avec le jour. Elle y brûle. On la porte au bûcher à l’aube. Et tous les spectres qui ont bu jusqu’à l’ivresse et qui se noient dans ses bras à peine soutenus par des lumières criardes et stroboscopiques, soulés par ce trop-plein de musique insupportable, sortent et brûlent leurs ailes à la lumière du jour. A peine quelques pas dehors, vacillant, cherchant leurs clefs dans leurs poches sans fond, ils se retournent sur celle qu’ils ont ramassé sur une piste trop clinquante et là, ils doutent déjà. Ils doutent d’avoir été avec cette fille qui à présent, en pleine lumière, se traîne sur le macadam sale.
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase (ou ici des trois premières) d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase (ou ici des trois premières) d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.

 Kiki un oiseau très petit, presque riquiqui, se baladait tranquillement lorsqu'il rencontra un gros ours, Blaise, vraiment balèze.
Kiki un oiseau très petit, presque riquiqui, se baladait tranquillement lorsqu'il rencontra un gros ours, Blaise, vraiment balèze.
 « Quelqu'un que j'ai connu autrefois écrit que nous renonçons à nos rêves par crainte de l'échec ou pire par crainte de la réussite ».
« Quelqu'un que j'ai connu autrefois écrit que nous renonçons à nos rêves par crainte de l'échec ou pire par crainte de la réussite ».
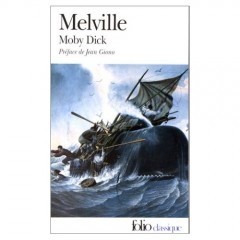


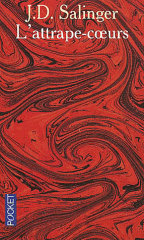 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.

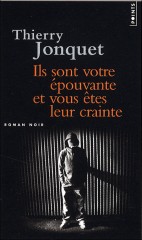 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
