 "Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
"Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
Pablo Picasso
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Olivier Leduc
 "Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
"Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
Pablo Picasso

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine ». Franz Kafka, La Métamorphose.
Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il réalisa en jetant un regard circulaire dans sa chambre à quel point il était devenu nuisible pour sa famille, ses proches, pour la société et aussi pour lui-même. Ce n’était d’ailleurs plus une chambre qu’il avait sous les yeux mais la tanière d’une bête hideuse, un antre repoussant, une bauge.
Imaginez une pièce rectangulaire étriquée sous les toits et des cloisons trop proches, une misérable lucarne condescendant à laisser entrer quelques rais de lumière, quelques tuiles manquant à l’appel et remplacées par une vielle toile percée, un méchant parquet usé, noirci, attaqué par les champignons et dont les lattes se dérobaient le plus souvent sous les pieds au lieu d’y offrir un appui ferme.
Jetez dans cette horrible pièce pêle-mêle, un peu de vaisselle, des habits élimés, souillés, macérant de sueur, de vieux journaux, de la nourriture et des restes, du tabac, des bouteilles d’alcool et un tas de choses dont on ne saurait dire maintenant à quoi elles pouvaient bien servir.
Ajoutez-y par endroits, des vomissures, de l’urine et même des excréments et laissez une main géante attraper le tout et secouer énergiquement l’ensemble de manière à tout retourner sans dessus dessous.
Tel était le spectacle qui s’offrait aux yeux ahuris de Grégoire Samsa. Il scrutait de son lit tout autour de lui avec un regard vierge cet infâme endroit où il avait vécu et il ne comprenait pas comment tout cela était arrivé. Comment il avait pu passer ses journées, terré dans cette chambre innommable, telle une vermine repoussante, crasseuse, crottée, excrémenteuse, pataugeant dans ce bouge immonde, cette sentine, comme un porc dans une bauge. Il ne comprenait pas comment il avait pu manger et boire dans cette pièce et même y dormir. C’était comme s’il avait été frappé violemment à la tête et qu’il se réveillait après une longue convalescence.
Et maintenant qu’il reprenait ses sens, des relents immondes lui tournèrent le cœur et l’auraient fait débagouler s’il ne s’était pas enfui en courant de cet infâme endroit. Tout son corps était tendu vers une unique chose à accomplir : courir, courir loin.
Dehors il avala une grande bouffée d’air frais et il cessa de se sentir une vermine.
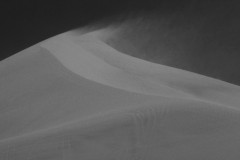 Cendriers en verre, transparents ou opaques, colorés ou noirs, en matière plastique ou en bois exotique, affublés de ces logos publicitaires tapageurs, comme des appels à ne fréquenter qu’une seule marque de tabac, ils trônaient ou plutôt jonchaient tout l’espace restant à disposition de mon petit appartement, empêchant des centaines de mégots de finir leur vie incandescente sur la moquette beige, le faux parquet ou le carrelage et ces cendriers débordants, je ne pouvais plus les souffrir, soutenir leur regard, voir leur contenu m’était devenu plus insupportable encore que de porter à mes lèvres une cigarette, à tel point, qu’il me prit la folie, car maintenant j’ose utiliser ce terme, de vider le contenu de tous les cendriers dans un grand sac poubelle noir, de ceux qu’on réserve aux tontes d’herbe, comme une révolte, un geste salvateur pour m’empêcher d’étouffer dans le gris de mon existence, dans la fumée de mes dépendances, dans l’ébène de ma résignation et il vrai que les premiers jours après, un grand poids m’avait quitté, comme par enchantement, le nuage noir qui s’évertuait à me suivre, comme attaché à mon existence et me déversant de la tristesse telle l’eau qui coule, s’était vaporisé, laissant place à des ciels azur, un horizon calme et ombragé, des lendemains soleilleux plein d’espérance et pour la première fois depuis bien longtemps, j’avançai dans la vie, léger, neuf, confiant et heureux presque, humant l’air vif et frais des campagnes environnantes comme de subtiles flagrances, m’enivrant de l’oxygène pur qui avait depuis plusieurs années déserté mes pauvres poumons goudronneux, poisseux comme du bitume, gorgés de tous les poisons vendus par les marchands de malheur et de tabac et il me semblait revivre comme un nouveau-né plongé dans un monde nouveau, écarquillant les yeux à chaque coin de rue, m’émerveillant de tout et de rien, m’extasiant de si peu, m’exclamant peut-être trop, goûtant tout, m’enivrant comme soulé de vie et cet état euphorique, dont je pressentais qu’il ne pouvait être qu’éphémère, se prolongea quelques jours, déclina un peu, eut quelques soubresauts comme un malade qui refuse l’agonie puis disparut définitivement laissant place à une mélancolie, une tristesse quasi infinie et à un manque insoutenable de nicotine, lancinant, ne laissant aucun répit que cela soit au bureau, dans la voiture, dans mon appartement, dans la rue ou bien évidemment au café, où les volutes grises enrubannant l’atmosphère chaud et sombre me tournaient la tête et m’obligèrent à fuir au plus vite cet endroit enfumé, confiné, autrefois agréable mais qui était devenu maintenant un enfer pour un écraseur de mégot comme moi qui essaye d’arrêter.
Cendriers en verre, transparents ou opaques, colorés ou noirs, en matière plastique ou en bois exotique, affublés de ces logos publicitaires tapageurs, comme des appels à ne fréquenter qu’une seule marque de tabac, ils trônaient ou plutôt jonchaient tout l’espace restant à disposition de mon petit appartement, empêchant des centaines de mégots de finir leur vie incandescente sur la moquette beige, le faux parquet ou le carrelage et ces cendriers débordants, je ne pouvais plus les souffrir, soutenir leur regard, voir leur contenu m’était devenu plus insupportable encore que de porter à mes lèvres une cigarette, à tel point, qu’il me prit la folie, car maintenant j’ose utiliser ce terme, de vider le contenu de tous les cendriers dans un grand sac poubelle noir, de ceux qu’on réserve aux tontes d’herbe, comme une révolte, un geste salvateur pour m’empêcher d’étouffer dans le gris de mon existence, dans la fumée de mes dépendances, dans l’ébène de ma résignation et il vrai que les premiers jours après, un grand poids m’avait quitté, comme par enchantement, le nuage noir qui s’évertuait à me suivre, comme attaché à mon existence et me déversant de la tristesse telle l’eau qui coule, s’était vaporisé, laissant place à des ciels azur, un horizon calme et ombragé, des lendemains soleilleux plein d’espérance et pour la première fois depuis bien longtemps, j’avançai dans la vie, léger, neuf, confiant et heureux presque, humant l’air vif et frais des campagnes environnantes comme de subtiles flagrances, m’enivrant de l’oxygène pur qui avait depuis plusieurs années déserté mes pauvres poumons goudronneux, poisseux comme du bitume, gorgés de tous les poisons vendus par les marchands de malheur et de tabac et il me semblait revivre comme un nouveau-né plongé dans un monde nouveau, écarquillant les yeux à chaque coin de rue, m’émerveillant de tout et de rien, m’extasiant de si peu, m’exclamant peut-être trop, goûtant tout, m’enivrant comme soulé de vie et cet état euphorique, dont je pressentais qu’il ne pouvait être qu’éphémère, se prolongea quelques jours, déclina un peu, eut quelques soubresauts comme un malade qui refuse l’agonie puis disparut définitivement laissant place à une mélancolie, une tristesse quasi infinie et à un manque insoutenable de nicotine, lancinant, ne laissant aucun répit que cela soit au bureau, dans la voiture, dans mon appartement, dans la rue ou bien évidemment au café, où les volutes grises enrubannant l’atmosphère chaud et sombre me tournaient la tête et m’obligèrent à fuir au plus vite cet endroit enfumé, confiné, autrefois agréable mais qui était devenu maintenant un enfer pour un écraseur de mégot comme moi qui essaye d’arrêter.
431 mots pour cette longue phrase ! Mieux que Proust ! mais avec, il faut bien l'avouer, beaucoup moins de talent..
 Une très longue phrase de Marcel Proust : près de 400 mots !
Une très longue phrase de Marcel Proust : près de 400 mots !
"Canapé surgi du rêve entre les fauteuils nouveaux et bien réels, petites chaises revêtues de soie rose, tapis broché de table de jeu élevé à la dignité de personne depuis que, comme une personne, il avait un passé, une mémoire, gardant dans l’ombre froide du salon du quai Conti le hâle de l’ensoleillement par les fenêtres de la rue Montalivet (dont il connaissait l’heure aussi bien que madame Verdurin elle-même) et par les portes vitrées de Doville, où on l’avait emmené et où il regardait tout le jour au-delà du jardin fleuriste la profonde vallée de la […] en attendant l’heure où Cottard et le violiste feraient ensemble leur partie ; bouquets de violettes et de pensées au pastel, présent d’un grand artiste ami, mort depuis, seul fragment survivant d’une vie disparue sans laisser de traces, résumant un grand talent et une longue amitié, rappelant son regard attentif et doux, sa belle main grasse et triste pendant qu’il peignait ; encombrement joli, désordre des cadeaux de fidèles qui a suivi partout la maîtresse de maison et a fini par prendre l’empreinte et la fixité d’un trait de caractère, d’une ligne de la destinée ; profusion des bouquets de fleurs, des boites de chocolat qui systématisait, ici comme là-bas, son épanouissement suivant un mode de floraison identique : interpolation curieuse des objets singuliers et superflus qui ont l’air de sortir de la boîte où ils ont été offerts et qui restent toute la vie ce qu’ils ont été d’abord, des cadeaux du Premier Janvier ; tous ces objets enfin qu’on ne saurait isoler des autres, mais qui pour Brichot, vieil habitué des fêtes des Verdurin, avaient cette patine, ce velouté des choses auxquelles, leur donnant une sorte de profondeur, vient s’ajouter leur double spirituel ; tout cela, éparpillé, faisait chanter devant lui comme autant de touches sonores qui émerveillaient dans son cœur des ressemblances aimées, des réminiscences confuses et qui, à même le salon actuel qu’elles marquetaient çà et là, découpaient, délimitaient comme fait par un beau jour un cadre de soleil sectionnant l’atmosphère, les meubles et les tapis, poursuivant d’un coussin à porte-bouquets, d’un tabouret au relent d’un parfum, d’un mode d’éclairage à une prédominance de couleurs, sculptaient, évoquaient, spiritualisaient, faisaient vivre une forme qui était comme la figure idéale, immanente à leurs logis successifs, du salon des Verdurin".

Bonne et heureuse année 2009 !
"Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt". Albert Einstein
"Le 1er janvier 1945 à Hiroshima, les gens s'étaient souhaité une bonne et heureuse année". Philippe Geluck, bande déssinée Le Chat.
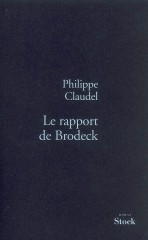
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien ». Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck.
Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Il y a des circonstances qui vous entraînent loin, trop loin sans doute et à votre insu. Comme une rivière tumultueuse qui vous charrie tel un rondin de bois, au début doucement. Avec tendresse même, vous laissant profiter du spectacle de ses berges verdoyantes, hérissées d’arbres bedonnants aux branches souples, assoiffées, ployant et touchant presque la surface de l’eau. Voyage tranquille vous permettant d’humer les senteurs provenant des rives du cours d’eau paisible : tapis bigarré d’Angéliques sauvages, Pas-d’âne, Soucis d’eau, Swerties vivaces ou grassettes communes, d’où exhalent des flagrances délicates.
Voilà un charmant voyage, vous vous dites. Mais arrivé à un méchant coude, le lit se resserre et la pente auparavant douce comme un chaton se métamorphose en redoutable tigresse. Vous ne vous promenez plus le long d’une calme et paisible rivière mais c’est un bouillonnant torrent qui vous emporte comme une vulgaire et anodine coquille de noix, ballottée, secouée dans les remous d’une rive à l’autre, entraînée par ce méchant courant. Les méandres se succèdent, les affluents aussi et on ne sait guère où le voyage va se terminer.
C’était ce voyage tumultueux semé d’embûches, inoffensif au début mais terrible ensuite qui m’avait entraîné si loin. Tout s’était enchaîné trop vite sans que je puisse reprendre mon souffle, sans que je puisse réfléchir à la portée de mes actes anodins en apparence.
Etait-ce une illusion ? Cette impression de n’y être pour rien. D’avoir laissé faire les choses comme un spectateur.
Je n’en sais toujours rien. Mais le fait est là : j’étais devenu un criminel. J’avais laissé mon voisin atteint de la maladie d’Alzheimer et gravement allergique manger des cacahouètes et je l’avais regardé suffoquant, sans lever le plus petit doigt. J’aurais pu saisir le combiné, composer les deux chiffres du SAMU…
Mais je n’avais rien fait.
Je ne l’avais pas tué : je l’avais laissé mourir. Etait-ce si différent ?
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Il était une fois, un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream». Le Vieil Homme et la Mer, Ernest Hemingway.
Il était une fois, un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Il avait tant ramené de poissons, tant promené sa silhouette pataude sur le pont et dans les embruns, tant navigué sur son vieux chalutier rouillé, que son cœur s’était gorgé d’eau, de sel et de solitude. Perdu au milieu des flots, loin de tout, des hommes, des terres, du bruit des mots, de la musique, des pas des hommes, il se plaisait : là, perdu dans l’immensité bleue, était sa place.
Pendant presque un demi-siècle, son chalutier l’avait conduit à suivre les courants chauds et les bancs de poissons. Il y a longtemps, c’était un art, un exercice périlleux, une habile technique qui s’apprenait laborieusement et patiemment avec le temps : connaître la météorologie, les vents et les nuages, suivre le vol des oiseaux, examiner l’écume, goûter le sel de l’eau… Maintenant c’était plus triste. Il n’y avait plus que des points qui scintillaient sur l’écran vert de son sonar. Ça bougeait, ça se regroupait, ça ondoyait et lui suivait du mieux qu’il le pouvait avec les quelques tonnes de ferraille que son antique diesel tachait de pousser. La coque craquait, gémissait, criait sous l’effet du tangage et fréquemment quand les éléments se déchainaient, quand le ciel et l’eau n’étaient plus qu’un, que le vent sifflait à rendre fou et les vagues déferlaient, jetant leur écume baveuse partout et que le vieux bateau enfournait, ployant sous le paquet de mer, noyant sa proue dans la vague, le vieux marin espérait presque le naufrage.
Là, il avait vécu, vibré, sué, espéré, frémi et vieilli.
Là, il voulait mourir.
Il les distinguait ces bras d’eau, lugubres, froids, glaçants, qui l’entouraient, l’encerclaient, l’étouffaient pour l’entraîner lui et son rafiot, dans sa dernière demeure, dans ce qui sera son tombeau dans la froideur et l’obscurité des fonds marins où il espérait que quelques sirènes voudraient lui prendre la main pour le rassurer. Car il avait beau être marin, vaillant, brave et ardent, avoir le muscle sec et puissant, le regard vif et bleu, le front haut et un cœur d’irlandais, la grande faucheuse qui cogne à la porte de sa cabine le faisait frissonner. Son bateau disloqué, fléchissant sous les paquets d’eau de mer et plongeant dans l’abîme, il l’imaginait. Le fluide glacé inondait la cabine, montait inexorablement, et pénétrait en tout, comme un venin dans des veines. Sa bouche, ses fosses nasales, sa gorge, ses poumons cherchaient désespérément quelque bouffée d’air salvatrice. Mais rien. Rien que le silence, le froid, l’obscurité et des bulles qui s’échappent vers la surface qui s’éloigne à jamais.
Aujourd’hui la mer était calme comme un lac, pas une vague, pas une ride sur cette plate immensité. Et le vieux marin, un rictus au coin des lèvres sèches, ajustant son bonnet et portant son regard loin, très loin, là où les goélands se perdent dans les nuages, pensa que la faucheuse, toute de noire vêtue, pouvait toujours l’astiquer sa faux et la ranger au placard.
Aujourd’hui il allait pouvoir pêcher, sereinement.
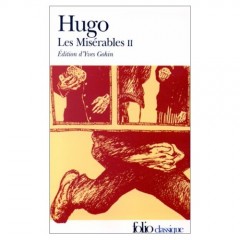 Les Misérables, Victor Hugo
Les Misérables, Victor Hugo
Quatrième partie, livre quinzième, La rue de l'homme-armé, Les excès de zèle de Gavroche :
"Pour la seconde fois, il s'arrêta net.
- Tiens, dit-il, c'est lui. Bonjour, l'ordre public.
Les étonnements de Gavroche étaient courts et dégelaient vite.
- Où vas-tu, voyou ? cria le sergent.
- Citoyen, dit Gavroche je ne vous ai pas encore appelé bourgeois. Pourquoi m'insultez-vous ?
- Où vas-tu, drôle ?
- Monsieur, reprit Gavroche, vous étiez peut-être hier un homme d'esprit, mais vous avez été destitué ce matin.
- Je te demande où tu vas, gredin ?
Gavroche répondit :
- Vous parlez gentiment. Vrai, on ne vous donnerait pas votre âge. Vous devriez vendre tous vos cheveux cent francs la pièce. Cela vous ferait cinq cent francs.
- Où vas-tu ? où vas-tu ? où vas-tu, bandit ?
Gavroche reprit :
- Voilà de vilains mots. La première fois qu'on vous donnera à téter , il faudra qu'on vous essuie mieux la bouche.
Le sergent croisa la bayonnette.
- Me diras-tu où tu vas, à la fin, misérable ?
- Mon général, dit Gavroche, je vas chercher le médecin pour mon épouse qui est en couches.
- Aux armes ! cria le sergent.
Se sauver par ce qui vous a perdu, c'est là le chef-d'oeuvre des hommes forts; Gavroche mesura d'un coup d'oeil toute la situation. C'était la charette qui l'avait compromis, c'était à la charette de le protéger.
Au moment où le sergent allait fondre sur Gavroche, la charette, devenue projectile et lancée à tour de bras, roulait sur lui avec furie, et le sergent, atteint en plein ventre, tombait à la renverse dans le ruisseau pendant que son fusil partait en l'air.
Au cri du sergent, les hommes du poste étaient sortis pêle-mêle; le coup de fusil détermina une décharge générale au hasard, après laquelle on rechargea les armes et l'on recommença.
Cette mousquetade à colin-maillard dura un bon quart d'heure, et tua quelques carreaux de vitre".

"Un écrivain américain à chaque ouvrage repart à zéro : le succès de l'oeuvre précédente ne lui garantit nullement que son éditeur ne refusera pas un nouveau manuscrit trop faible. Quiconque en france s'est trouvé une fois édité, si son début a été seulement honorable, a toutes chances de l'être toujours : il y compte d'ailleurs, et ne pourrait voir dans un refus qu'un affront ou une ténébreuse manoeuvre."
"Dans la conscience de chacun, le sentiment de quelque chose de dérisoire et même de coupable a fini par colorer insidieusement les réactions d'ailleurs de plus en plus apeurées du sens individuel, et même là où, comme en littérature le goût n'avait aucune raison de laisser prescrire son droit à trancher immédiatement, on dirait qu'une contamination s'est produite : à la réaction extrêmement prudente et cauteleuse, pleine d'inhibitions, qui est aujourd'hui celle du lecteur moyen quand on le sollicite de juger en l'abscence de tout repère critique, on sent que la caution des spécialistes auxquels il se réfère d'instinct en toutes matières, lui fait ici défaut cruellement, qu'il a le sentiment de s'avancer en terrain miné, de n'avoir pas en mains tous les éléments".
"Le grand public, par un entraînement inconscient, exige de nos jours comme une preuve cette transmutation bizarre du qualitatif en quantitatif, qui fait que l'écrivain aujourd'hui se doit de représenter, comme on dit, une surface, avant même parfois d'avoir un talent".
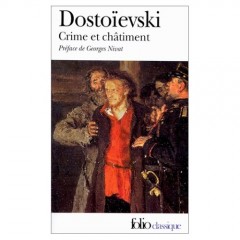 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la toute petite chambre qu’il louait dans la ruelle S… et se dirigea d’un pas indécis et lent vers le pont K ». Fédor Dostoïevski, Crime et châtiment
Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la toute petite chambre qu’il louait dans la ruelle S… et se dirigea d’un pas indécis et lent vers le pont K. Par bonheur, il ne croisa pas sa voisine de palier, Irina, qui était sortie quelques minutes avant lui. Il ne revit pas sa frêle silhouette, ses avant bras laiteux et ses doux cheveux blonds. Il ne croisa pas son regard, bleu comme un reflet du ciel sur la banquise. Il n’eut pas à sonder son cœur, à parler à ses yeux pour lui arracher les mots que ses lèvres ne consentaient à lui susurrer.
Elle l’aimait toujours et il l’aurait lu dans l’azur de ses yeux. Elle l’aimait et elle avait rompu. Elle avait rompu après une folle semaine où leurs cœurs s’étaient élancés, tels des chevaux prenant le mors aux dents, fougueusement, passionnément, dans une merveilleuse histoire d’amour.
Il était à présent arrivé sur le pont K. Le jour avait fini de décliner et de vieux lampadaires en fonte aspergeaient une lumière timide, blafarde, spectrale et fantomatique, découpant la silhouette du jeune homme grossièrement en une forme indécise et tremblante comme une flamme dans le vent. Le bruit de la ville parvenait faiblement à ses oreilles, et il ne vit pas une jeune femme s’approchait de lui, comme si tout son être n’était plus que ce corps se penchant au-dessus du parapet.
Se pencher un peu plus.
Un point au bout d’une ligne. Fermer ses yeux pour ne plus voir. Une lumière qu’on éteint le soir quand les volets sont tirés ; et l’obscurité qui gorge tout l’espace. Il voulait tout cela à la fois. Ou plutôt, il ne voulait plus rien, pas même continuer à vivre.
Il enjamba le parapet. L’air était doux. Les reflets des lumières ondoyaient devant lui. Les flots étaient maintenant sous ses pieds et il était prêt à se faire engloutir par le trouble de l’eau.
L’inconnue n’hésita plus, elle accéléra le pas, fonça sur lui et lui saisit le poignet, l’obligeant à revenir de l’autre côté. Du côté des vivants. Il croisa son regard, magnifié. Elle avait un beau sourire.
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes ». Luis Sepulveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour
Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Nous marchions en file indienne à découvert et à flanc de colline et à chaque pas, je redoutais un peu plus que les cieux gris, pesants et lourds, poisseux et humides nous avalent comme une vulgaire bouchée, proie trop facile dans le déchaînement des forces de la nature. Des éclairs zébraient à présent l’atmosphère charbonneuse et il n’y avait en vue, nul endroit pour nous abriter. Cela semblait tonner de partout, résonnait tout autour comme si nous avions été enfermés dans une grosse caisse qu’un mauvais génie aurait frappé sans relâche et avec force. Nous aurions pu marcher des heures, à perdre haleine, sans jamais trouver un arbre, un toit, quelque porche ou abri pour nous protéger de la pluie, des bourrasques et de la foudre, pour nous sécher un peu et nous reposer du déluge qui s’abattait sur nos têtes. Rien sur l’horizon. Lisse tel le crâne d’un chauve. Désespérant et inquiétant.
Nous finîmes par nous arrêter, épuisés, las, vidés et nous nous écroulâmes tous ensemble le nez dans la terre comme des quilles balayées méchamment, abandonnant tous dans cet épuisement contagieux. Ce que nous aurions dû décider par intelligence, nous en fûmes contraint par la force. La nature reprend toujours le dessus sur l’homme et nous passâmes la nuit, trempés jusqu’à l’os, tremblant, comateux, délirant de fièvre, le corps dans la boue mais à l’abri de la foudre.
Quand le jour parut, nous fûmes saisis par la clarté du ciel : tout avait été balayé. Pas un nuage, plus de traces du combat de la veille entre les cieux et la terre. Seul stigmate : de la boue sèche sur nos habits et nos corps, de la fièvre dans nos têtes et la peur au ventre d’être passé près de l’irréparable.
 "Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
"Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
Anna Gavalda

"Les écrivains sont fragiles. Tous les êtres humains sont fragiles, mais les écrviains sont vraiment des petites choses très fragiles qui peuvent se casser facilement... Donc tout ce qui leur donne du soutien, qui leur remonte le moral, est très bon".
J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.

La tante Germaine nous avait mis en garde de ne jamais utiliser cette vieille Underwood mais c’était juste avant son décès, une noyade, bête et inexplicable, dans sa baignoire en fonte et personne n’y prêta attention sachant que la tante Germaine sur la fin, n’avait plus toute sa tête.
Je finis, je ne sais plus comment, par récupérer entre autre cette machine à écrire et, ne voulant pas la jeter, elle se retrouva oubliée sous une couverture au grenier pendant de longues années.
Evidemment, on remplit son grenier, d’un tas de choses, souvent inutiles ou cassées, de babioles dont on aurait du se débarrasser et dont on ne se servira sans doute plus jamais. Tout cela dort, là-haut, au-dessus de nos têtes, dans un amoncellement de cartons et quand on finit par faire un peu de rangement, le grenier étant plein à craquer, on retrouve avec ravissement de vieilles bricoles qu’on prend presque pour des reliques.
J’avais, en triant, jeté beaucoup mais je ne pouvais me résoudre à me séparer de la vieille Underwood avec ses touches rondes et blanches, sa bouille prognathe, étalant son clavier comme les dents chez le dentiste, et son gros rouleau surplombant sa vieille carcasse. Plus je la regardais, plus elle semblait m’inviter à la descendre dans mon bureau, ce que je consentis à faire.
C’était puéril car je n’en avais aucune utilité. Cette pauvre machine des années 1920 ne supportait aucune comparaison face à mon PC assisté d'une imprimante laser.
Je disposai l’antédiluvienne machine dans un coin de mon bureau. Et une remarque de mon épouse ne se fit pas attendre :
— Qu’est-ce que c’est que cette horreur ? me dit-elle.
— Une Underwood, lui répondis-je.
— Une Underwood. Et que comptes-tu en faire ? reprit-elle.
— Je n’en sais rien.
— Tu vas me faire le plaisir de t’en débarrasser.
Elle regarda la machine puis rajouta :
— Je ne l’aime pas cette machine. On dirait qu’elle me fixe.
Et je repris en lui demandant, comment elle pouvait ne pas aimer une machine à écrire, et comment une machine à écrire pouvait la fixer. Je mis tout cela sur le compte de la fatigue et elle s’énerva ; nous nous engueulâmes mais l’Underwood resta sur mon bureau. Le lendemain, je m’amusai même à taper dessus la liste des courses et surprise, le clavier fonctionnait à merveille ! J’avais auparavant retrouvé un vieux ruban dans un des tiroirs de mon secrétaire. L’après-midi, j’allai faire les courses à l’hypermarché, avec ma liste tapée avec la vieille machine et j’attendis une heure aux caisses : bug informatique. L’électronique n’est finalement pas aussi sûre qu’une bonne vieille mécanique…
Quelques jours plus tard, je me resservis de l’Underwood pour taper, pour le plaisir, le cours de français de Caroline. Je lui avais bien entendu demandé auparavant si je pouvais le faire… Et le lendemain soir, je l’attendais avec impatience, pour lui demander si je n’avais pas fait de fautes sur les deux feuillets que je lui avais tapés pour son cours. Elle avait une mine décomposée, les cheveux défaits, les yeux humides et m’expliqua, en sanglotant, que ça avait été les pires heures de cours de toute sa carrière et qu’elle ne comprenait pas ce qui avait littéralement déchaîné les collégiens à son encontre.
Je laissai de côté la machine à écrire, déçu. Il y eut les vacances de Pâques à la mer et l’Underwood sortit de mon esprit.
Je touchai de nouveau son clavier fin d’avril, pour taper une facture pour l’assistante maternelle que je déposai le soir même. Le lendemain, elle nous appelait, catastrophée de ne pas pouvoir garder notre bébé, elle était à l’hôpital, s’étant faite une luxation de la rotule du genou en revenant de la boite aux lettres.
Plusieurs semaines plus tard, à l’occasion de l’anniversaire de Caroline, j’en profitai pour taper un petit mot doux avec la vieille machine à écrire de ma tante. Ce fut la dernière fois, que j’utilisai cette maudite machine. Evidemment, j’ai peine à croire qu’une machine puisse faire quoi que ce soit à notre encontre, qu’elle soit douée d’une capacité à faire le mal mais encore aujourd’hui, je repense à la mise en garde de ma tante Germaine et bien que je ne sois pas du tout superstitieux, j’ai des doutes.
Après avoir lu son petit mot et déballé son cadeau, Caroline s’est effondrée brutalement. Les médecins ont conclu à un AVC, c'est-à-dire une attaque cérébrale.
Cela fait maintenant un an, jour pour jour, qu’elle nous a quittés.
Je crois qu'on écrit pour créer un monde dans lequel on puisse vivre.
Anaïs Nin

"On devrait vivre a posteriori. On décide tout trop tôt".
 Au fruits de la passion, Daniel Pennac
Au fruits de la passion, Daniel Pennac
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu : "Longtemps, je me suis couché de bonne heure".
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ce n’était pas par nécessité. Non plus par hygiène de vie ou pour une quelconque mais sérieuse raison. Tous les soirs, vers les vingt heures, mon corps prenait congé et préférait se plonger dans les délices ouatés de Morphée. C’était plus un abandon, une désertion, qu’une réelle volonté de ma part d’aller me coucher.
A vrai dire, c’était peut être bien une habitude, vestige de mon enfance que les parents imposent à leur progéniture et qui se perpétue si rien n’y fait obstacle, comme ce dû être le cas pour moi, jusqu’à un âge avancé.
J’étais dans ma vingt-cinquième année et je me couchais toujours de bonne heure. Certains auraient pu en sourire, d’autres en être étonné mais pour ma part, je n’y voyais aucune espèce d’étrangeté.
Et ce fut plus tard, à l’occasion d’un anniversaire d’un ami, ou plutôt au cours de la soirée, après les festivités, que je pris conscience en prenant pour la première fois la plume que je pouvais occuper une partie de la soirée à un travail plus intéressant et passionnant que celui d’écraser avec ma lourde tête l’oreiller en plume d’oie : ma vocation était née.
Ce soir-là, j'avais joué avec les rimes et m'étais essayé à la contine. J’avais noirci une pauvre page en deux heures mais ma joie d’avoir pour la première fois créé quelque chose était inénarrable. J’écrivais et d’un coup, j’existais. Comme si mon stylo devenait un prolongement vital. Comment d’ailleurs avais-je pu me passer de ce qui allait devenir une drogue, pendant toutes ces années ?
Très vite, je bifurquais vers la nouvelle et bien plus tard, elle finit par me lasser : c’était inévitable. Il me fallait plus d’espace pour que sortent les personnages qui frappaient à la porte de mon imagination. Le roman devenait une évidence, une nécessité.
Je ne me couche plus de bonne heure. J’ai troqué mon stylo pour l’azerty d’un PC ultraportable et je ne compte plus les pages qui sont sorties de mon imprimante.
J’écris et cela me suffit.

 Quatrième de couverture, Folio poche, Exercices de style, Raymond Queneau :
Quatrième de couverture, Folio poche, Exercices de style, Raymond Queneau :
« Le narrateur rencontre, dans un autobus, un jeune homme au long cou, coiffé d’un chapeau orné d’une tresse au lieu de ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s’asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus.
Cette brève histoire est racontée quatre-vingt-dix-neuf fois, de quatre-vingt-dix-neuf manières différentes. Mise en images, portée sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune extraordinaire. Exercices de style est un des livres les plus populaires de Queneau ».
Voici, en quelque sorte, une centième version :
