
"De certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Malgré le temps passé, malgré la douceur des autres mots et des autres regards."
Delphine de vigan, D'après Une histoire vraie, JC Lattés, PRIX RENAUDOT et PRIX GONCOURT DES LYCEENS
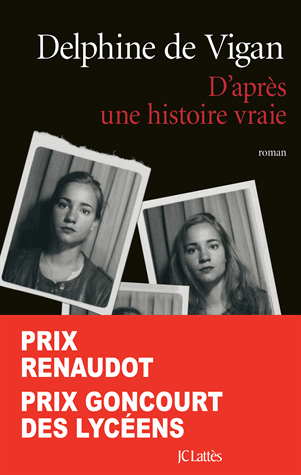
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Olivier Leduc

"De certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Malgré le temps passé, malgré la douceur des autres mots et des autres regards."
Delphine de vigan, D'après Une histoire vraie, JC Lattés, PRIX RENAUDOT et PRIX GONCOURT DES LYCEENS
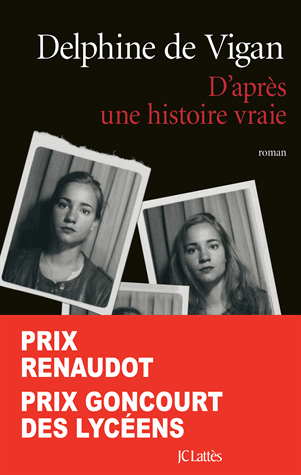
 Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.
Après En finir avec Eddy Bellegueule, un roman poignant et fort, Edouard Louis a écrit Histoire de la violence. Le roman paraitra, aux Editions du Seuil, le 7 janvier.
En voici un résumé d'après l'auteur :
J’ai rencontré Reda un soir de Noël. Je rentrais chez moi après un repas avec des amis, vers quatre heures du matin. Il m’a abordé dans la rue et j’ai fini par lui proposer de monter dans mon studio. Ensuite, il m’a raconté l’histoire de son enfance et celle de l’arrivée en France de son père, qui avait fui l’Algérie. Nous avons passé le reste de la nuit ensemble, on discutait, on riait. Vers six heures du matin, il a sorti un revolver et il a dit qu’il allait me tuer. Il m’a insulté, étranglé, violé. Le lendemain les démarches médicales et judiciaires ont commencé.
Source : http://edouardlouis.com/2015/11/05/a-paraitre-histoire-de-la-violence/
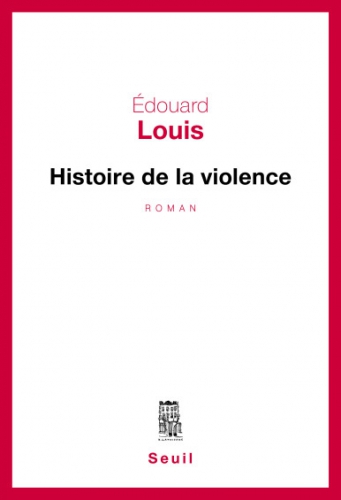
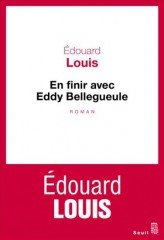 Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €
Extrait de : En finir avec Eddy Bellegueule, d'Édouard Louis, Le Seuil, janvier 2014, 219 pages, 17 €
Livre 1
Picardie
(fin des années 1990 - début des années 2000)
Rencontre
De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n’ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître.
Dans le couloir sont apparus deux garçons, le premier, grand, aux cheveux roux, et l’autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché Prends ça dans ta gueule.
Le crachat s’est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l’odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons Regarde il en a plein la gueule ce fils de pute. Il s’écoule de mon œil jusqu’à mes lèvres, jusqu’à entrer dans ma bouche. Je n’ose pas l’essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d’un revers de manche. Il suffirait d’une fraction de seconde, d’un geste minuscule pour que le crachat n’entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas, de peur qu’ils se sentent offensés, de peur qu’ils s’énervent encore un peu plus.
Je n’imaginais pas qu’ils le feraient. La violence ne m’était pourtant pas étrangère, loin de là. J’avais depuis toujours, aussi loin que remontent mes souvenirs, vu mon père ivre se battre à la sortie du café contre d’autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d’insistance et mon père, sous l’emprise de l’alcool, qui fulminait Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça sale bâtard. Ma mère qui essayait de le calmer Calme-toi chéri, calme-toi mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c’était la règle, c’était ça aussi être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l’autre, la victime de sa saoulerie au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu’un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu’à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l’avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu’il extrayait pour en faire du boudin (le sang sur ses lèvres, son menton, son tee-shirt) C’est ça qu’est le meilleur, c’est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant quand mon père sectionnait sa trachée-artère étaient audibles dans tout le village.
J’avais dix ans. J’étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir je ne les connaissais pas. J’ignorais jusqu’à leur prénom, ce qui n’était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d’à peine deux cents élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leur démarche était lente, ils étaient souriants, ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j’ai d’abord pensé qu’ils venaient faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau ? La cour de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde : les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers Nous les petits on intéresse personne, surtout pas les grands bourges.
Dans le couloir ils m’ont demandé qui j’étais, si c’était bien moi Bellegueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m’ont posé cette question que je me suis répétée ensuite, inlassablement, des mois, des années,
C’est toi le pédé ?
En la prononçant ils l’avaient inscrite en moi pour toujours tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L’impossibilité de m’en défaire. C’est la surprise qui m’a traversé, quand bien même ce n’était pas la première fois que l’on me disait une chose pareille. On ne s’habitue jamais à l’injure.
Un sentiment d’impuissance, de perte d’équilibre. J’ai souri – et le mot pédé qui résonnait, explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque.
J’étais maigre, ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible, presque nulle. À cet âge mes parents me surnommaient fréquemment Squelette et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller. Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l’on disait volontiers Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c’est une bonne maladie.
(L’année d’après, fatigué par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j’entrepris de grossir. J’achetais des paquets de chips à la sortie de l’école avec de l’argent que je demandais à ma tante – mes parents n’auraient pas pu m’en donner – et m’en gavais. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères – elle s’exaspérait : Ça va pas te boucher ton trou du cul –, je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage, comme ces insectes qui se déplacent en nuages et font disparaître des paysages entiers. Je pris une vingtaine de kilos en un an.)
Ils m’ont d’abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu’à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L’un m’a saisi les bras pendant que l’autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens : les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C’est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense – devant ce type de scène, je veux dire : avec un regard extérieur – à l’humiliation, à l’incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur.
Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J’ouvrais la bouche le plus possible pour y laisser pénétrer l’oxygène, je gonflais la poitrine, mais l’air ne voulait pas entrer ; cette impression que mes poumons s’étaient soudainement remplis d’une sève compacte, de plomb. Je les sentais lourds tout à coup. Mon corps tremblait, semblait ne plus m’appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant qui s’affranchit de l’esprit, est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir. Le corps qui devient un fardeau.
Ils riaient quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d’oxygène (le naturel des classes populaires, la simplicité des gens de peu qui aiment rire, les bons vivants). Les larmes me montaient aux yeux, mécaniquement, ma vue se troublait comme c’est le cas lorsqu’on s’étouffe avec sa salive ou quelque nourriture. Ils ne savaient pas que c’était l’étouffement qui faisait couler mes larmes, ils s’imaginaient que je pleurais. Ils s’impatientaient.
J’ai senti leur haleine quand ils se sont approchés de moi, cette odeur de laitages pourris, d’animal mort. Les dents, comme les miennes, n’étaient probablement jamais lavées. Les mères du village ne tenaient pas beaucoup à l’hygiène dentaire de leurs enfants. Le dentiste coûtait trop cher et le manque d’argent finissait toujours par se transformer en choix. Les mères disaient De toute façon y a plus important dans la vie. Je paye encore actuellement d’atroces douleurs, de nuits sans sommeil, cette négligence de ma famille, de ma classe sociale, et j’entendrai des années plus tard, en arrivant à Paris, à l’École normale, des camarades me demander Mais pourquoi tes parents ne t’ont pas emmené chez un orthodontiste. Mes mensonges. Je leur répondrai que mes parents, des intellectuels un peu trop bohèmes, s’étaient tant souciés de ma formation littéraire qu’ils en avaient parfois négligé ma santé.
Dans le couloir le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté criaient. Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence, toujours. Pédale, pédé, tantouse, enculé, tarlouze, pédale douce, baltringue, tapette (tapette à mouches), fiotte, tafiole, tanche, folasse, grosse tante, tata, ou l’homosexuel, le gay. Certaines fois nous nous croisions dans l’escalier bondé d’élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me frapper au vu de tous, ils n’étaient pas si stupides, ils auraient pu être renvoyés. Ils se contentaient d’une injure, juste pédé (ou autre chose). Personne n’y prenait garde autour mais tout le monde l’entendait. Je pense que tout le monde l’entendait puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d’autres dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d’entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas et chuchotait sur mon passage, que j’entendais Regarde, c’est Bellegueule, la pédale.

Le Seuil, 2014
Quatrième de couverture « Je suis parti en courant, tout à coup. Juste le temps d'entendre ma mère dire Qu'est-ce qui fait le débile là ? Je ne voulais pas rester à leur côté, je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin, je n'appartenais plus à leur monde désormais, la lettre le disait. Je suis allé dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du Nord, les chemins de terre, l'odeur de colza, très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici. »
En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre.
Édouard Louis a 21 ans. Il a déjà publié Pierre Bourdieu: l'insoumission en héritage (PUF, 2013). En finir avec Eddy Bellegueule est son premier roman.

http://www.youtube.com/watch?v=tWxMe7jvUOU.
http://www.franceculture.fr/emission-du-jour-au-lendemain-edouard-louis-2014-03-26.


Tania Balachova
Léa Drucker
Emission Eclectik, sur France Inter du dimanche 13/06/10 avec pour invitée l'actrice Léa Drucker : un enregistrement de 1968 d'une interview de Tania Balachova actrice et professeur de théâtre française d'origine russe (1902-1973) :
L'interviewer dit : « Vous avez dit que vous croyez aux êtres timides. C'est un rapprochement avec vous-même ? ou... »
Tania Balachova répond : « Pas seulement avec moi-même, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'obstacle à surmonter dans n'importe quel art , la facilité est un obstacle terrible, parce qu'il faut avoir des problèmes et les vaincre pour devenir quelqu'un ».
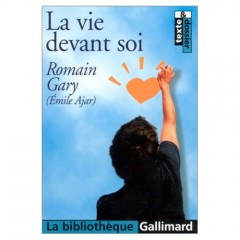 Il ne faut jamais désespérer. Si insignifiants ou désastreux que soient les résultats, il faut continuer sur le chemin de l’exigence, encore et encore.
Il ne faut jamais désespérer. Si insignifiants ou désastreux que soient les résultats, il faut continuer sur le chemin de l’exigence, encore et encore.
Il y a plus de vingt ans notre professeur de français nous avait emmenés voir un film en noir et blanc, La vie devant soi. Je me rappelle la salle de cinéma, les fauteuils, les copains, et nos pieds qui ne tenaient pas en place. L’ennui. Ou était-ce plutôt ce trait commun aux adolescents que nous étions alors et des groupes en général de suivre les leaders souvent grincheux et contestataires, indisciplinés et abêtis ? Avais-je réellement trouvé ce film ennuyeux ou m’étais-je rallié au groupe qui le trouvait assommant ?
Nous, élèves de 3ème1 d’un quartier populaire d’Amiens, avions ce jour-là été particulièrement pénibles. Pieds sur les fauteuils, brouhaha, cris intempestifs, rires gras, bruits en tout genre, nous avions exaspéré notre professeur exigeante, qui à coups de pavés Stendhaliens, d’Exercices de Queneau, de mitraille de J.P. Manchette, tenter de nous forger vaillamment une culture littéraire.
Certains romans se font désirer. Comme des voyages trop onéreux ou périlleux qu’on repousse du bout des doigts de peur qu’ils nous brûlent mais qui nous attirent imperceptiblement toujours un peu plus le temps passant. La vie devant soi de Roman Gary, prix Goncourt 1975, est un de ces ouvrages. Je l’ai cherché longtemps sur les étagères de la bibliothèque municipale, croyant le trouver près des racines du ciel ou des enchanteurs mais mon ticket n’était peut être plus valable et ce livre se dérobait toujours.
Aujourd’hui je l’ai déniché, l’ai ouvert presque religieusement et l’ai commencé. Vous dire que ce roman est merveilleux et superbe ne suffit pas. C’est un chef d’œuvre.
Voilà. Il ne faut jamais désespérer d’élèves, d’enfants qui ne lisent pas, chahutent ou se désintéressent de tout. Le déclic peut toujours se produire, même vingt ans plus tard.
 "Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
"Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste, une fois adulte".
Pablo Picasso

Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine ». Franz Kafka, La Métamorphose.
Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il réalisa en jetant un regard circulaire dans sa chambre à quel point il était devenu nuisible pour sa famille, ses proches, pour la société et aussi pour lui-même. Ce n’était d’ailleurs plus une chambre qu’il avait sous les yeux mais la tanière d’une bête hideuse, un antre repoussant, une bauge.
Imaginez une pièce rectangulaire étriquée sous les toits et des cloisons trop proches, une misérable lucarne condescendant à laisser entrer quelques rais de lumière, quelques tuiles manquant à l’appel et remplacées par une vielle toile percée, un méchant parquet usé, noirci, attaqué par les champignons et dont les lattes se dérobaient le plus souvent sous les pieds au lieu d’y offrir un appui ferme.
Jetez dans cette horrible pièce pêle-mêle, un peu de vaisselle, des habits élimés, souillés, macérant de sueur, de vieux journaux, de la nourriture et des restes, du tabac, des bouteilles d’alcool et un tas de choses dont on ne saurait dire maintenant à quoi elles pouvaient bien servir.
Ajoutez-y par endroits, des vomissures, de l’urine et même des excréments et laissez une main géante attraper le tout et secouer énergiquement l’ensemble de manière à tout retourner sans dessus dessous.
Tel était le spectacle qui s’offrait aux yeux ahuris de Grégoire Samsa. Il scrutait de son lit tout autour de lui avec un regard vierge cet infâme endroit où il avait vécu et il ne comprenait pas comment tout cela était arrivé. Comment il avait pu passer ses journées, terré dans cette chambre innommable, telle une vermine repoussante, crasseuse, crottée, excrémenteuse, pataugeant dans ce bouge immonde, cette sentine, comme un porc dans une bauge. Il ne comprenait pas comment il avait pu manger et boire dans cette pièce et même y dormir. C’était comme s’il avait été frappé violemment à la tête et qu’il se réveillait après une longue convalescence.
Et maintenant qu’il reprenait ses sens, des relents immondes lui tournèrent le cœur et l’auraient fait débagouler s’il ne s’était pas enfui en courant de cet infâme endroit. Tout son corps était tendu vers une unique chose à accomplir : courir, courir loin.
Dehors il avala une grande bouffée d’air frais et il cessa de se sentir une vermine.
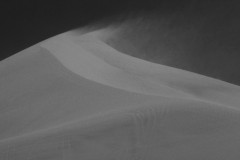 Cendriers en verre, transparents ou opaques, colorés ou noirs, en matière plastique ou en bois exotique, affublés de ces logos publicitaires tapageurs, comme des appels à ne fréquenter qu’une seule marque de tabac, ils trônaient ou plutôt jonchaient tout l’espace restant à disposition de mon petit appartement, empêchant des centaines de mégots de finir leur vie incandescente sur la moquette beige, le faux parquet ou le carrelage et ces cendriers débordants, je ne pouvais plus les souffrir, soutenir leur regard, voir leur contenu m’était devenu plus insupportable encore que de porter à mes lèvres une cigarette, à tel point, qu’il me prit la folie, car maintenant j’ose utiliser ce terme, de vider le contenu de tous les cendriers dans un grand sac poubelle noir, de ceux qu’on réserve aux tontes d’herbe, comme une révolte, un geste salvateur pour m’empêcher d’étouffer dans le gris de mon existence, dans la fumée de mes dépendances, dans l’ébène de ma résignation et il vrai que les premiers jours après, un grand poids m’avait quitté, comme par enchantement, le nuage noir qui s’évertuait à me suivre, comme attaché à mon existence et me déversant de la tristesse telle l’eau qui coule, s’était vaporisé, laissant place à des ciels azur, un horizon calme et ombragé, des lendemains soleilleux plein d’espérance et pour la première fois depuis bien longtemps, j’avançai dans la vie, léger, neuf, confiant et heureux presque, humant l’air vif et frais des campagnes environnantes comme de subtiles flagrances, m’enivrant de l’oxygène pur qui avait depuis plusieurs années déserté mes pauvres poumons goudronneux, poisseux comme du bitume, gorgés de tous les poisons vendus par les marchands de malheur et de tabac et il me semblait revivre comme un nouveau-né plongé dans un monde nouveau, écarquillant les yeux à chaque coin de rue, m’émerveillant de tout et de rien, m’extasiant de si peu, m’exclamant peut-être trop, goûtant tout, m’enivrant comme soulé de vie et cet état euphorique, dont je pressentais qu’il ne pouvait être qu’éphémère, se prolongea quelques jours, déclina un peu, eut quelques soubresauts comme un malade qui refuse l’agonie puis disparut définitivement laissant place à une mélancolie, une tristesse quasi infinie et à un manque insoutenable de nicotine, lancinant, ne laissant aucun répit que cela soit au bureau, dans la voiture, dans mon appartement, dans la rue ou bien évidemment au café, où les volutes grises enrubannant l’atmosphère chaud et sombre me tournaient la tête et m’obligèrent à fuir au plus vite cet endroit enfumé, confiné, autrefois agréable mais qui était devenu maintenant un enfer pour un écraseur de mégot comme moi qui essaye d’arrêter.
Cendriers en verre, transparents ou opaques, colorés ou noirs, en matière plastique ou en bois exotique, affublés de ces logos publicitaires tapageurs, comme des appels à ne fréquenter qu’une seule marque de tabac, ils trônaient ou plutôt jonchaient tout l’espace restant à disposition de mon petit appartement, empêchant des centaines de mégots de finir leur vie incandescente sur la moquette beige, le faux parquet ou le carrelage et ces cendriers débordants, je ne pouvais plus les souffrir, soutenir leur regard, voir leur contenu m’était devenu plus insupportable encore que de porter à mes lèvres une cigarette, à tel point, qu’il me prit la folie, car maintenant j’ose utiliser ce terme, de vider le contenu de tous les cendriers dans un grand sac poubelle noir, de ceux qu’on réserve aux tontes d’herbe, comme une révolte, un geste salvateur pour m’empêcher d’étouffer dans le gris de mon existence, dans la fumée de mes dépendances, dans l’ébène de ma résignation et il vrai que les premiers jours après, un grand poids m’avait quitté, comme par enchantement, le nuage noir qui s’évertuait à me suivre, comme attaché à mon existence et me déversant de la tristesse telle l’eau qui coule, s’était vaporisé, laissant place à des ciels azur, un horizon calme et ombragé, des lendemains soleilleux plein d’espérance et pour la première fois depuis bien longtemps, j’avançai dans la vie, léger, neuf, confiant et heureux presque, humant l’air vif et frais des campagnes environnantes comme de subtiles flagrances, m’enivrant de l’oxygène pur qui avait depuis plusieurs années déserté mes pauvres poumons goudronneux, poisseux comme du bitume, gorgés de tous les poisons vendus par les marchands de malheur et de tabac et il me semblait revivre comme un nouveau-né plongé dans un monde nouveau, écarquillant les yeux à chaque coin de rue, m’émerveillant de tout et de rien, m’extasiant de si peu, m’exclamant peut-être trop, goûtant tout, m’enivrant comme soulé de vie et cet état euphorique, dont je pressentais qu’il ne pouvait être qu’éphémère, se prolongea quelques jours, déclina un peu, eut quelques soubresauts comme un malade qui refuse l’agonie puis disparut définitivement laissant place à une mélancolie, une tristesse quasi infinie et à un manque insoutenable de nicotine, lancinant, ne laissant aucun répit que cela soit au bureau, dans la voiture, dans mon appartement, dans la rue ou bien évidemment au café, où les volutes grises enrubannant l’atmosphère chaud et sombre me tournaient la tête et m’obligèrent à fuir au plus vite cet endroit enfumé, confiné, autrefois agréable mais qui était devenu maintenant un enfer pour un écraseur de mégot comme moi qui essaye d’arrêter.
431 mots pour cette longue phrase ! Mieux que Proust ! mais avec, il faut bien l'avouer, beaucoup moins de talent..
 Une très longue phrase de Marcel Proust : près de 400 mots !
Une très longue phrase de Marcel Proust : près de 400 mots !
"Canapé surgi du rêve entre les fauteuils nouveaux et bien réels, petites chaises revêtues de soie rose, tapis broché de table de jeu élevé à la dignité de personne depuis que, comme une personne, il avait un passé, une mémoire, gardant dans l’ombre froide du salon du quai Conti le hâle de l’ensoleillement par les fenêtres de la rue Montalivet (dont il connaissait l’heure aussi bien que madame Verdurin elle-même) et par les portes vitrées de Doville, où on l’avait emmené et où il regardait tout le jour au-delà du jardin fleuriste la profonde vallée de la […] en attendant l’heure où Cottard et le violiste feraient ensemble leur partie ; bouquets de violettes et de pensées au pastel, présent d’un grand artiste ami, mort depuis, seul fragment survivant d’une vie disparue sans laisser de traces, résumant un grand talent et une longue amitié, rappelant son regard attentif et doux, sa belle main grasse et triste pendant qu’il peignait ; encombrement joli, désordre des cadeaux de fidèles qui a suivi partout la maîtresse de maison et a fini par prendre l’empreinte et la fixité d’un trait de caractère, d’une ligne de la destinée ; profusion des bouquets de fleurs, des boites de chocolat qui systématisait, ici comme là-bas, son épanouissement suivant un mode de floraison identique : interpolation curieuse des objets singuliers et superflus qui ont l’air de sortir de la boîte où ils ont été offerts et qui restent toute la vie ce qu’ils ont été d’abord, des cadeaux du Premier Janvier ; tous ces objets enfin qu’on ne saurait isoler des autres, mais qui pour Brichot, vieil habitué des fêtes des Verdurin, avaient cette patine, ce velouté des choses auxquelles, leur donnant une sorte de profondeur, vient s’ajouter leur double spirituel ; tout cela, éparpillé, faisait chanter devant lui comme autant de touches sonores qui émerveillaient dans son cœur des ressemblances aimées, des réminiscences confuses et qui, à même le salon actuel qu’elles marquetaient çà et là, découpaient, délimitaient comme fait par un beau jour un cadre de soleil sectionnant l’atmosphère, les meubles et les tapis, poursuivant d’un coussin à porte-bouquets, d’un tabouret au relent d’un parfum, d’un mode d’éclairage à une prédominance de couleurs, sculptaient, évoquaient, spiritualisaient, faisaient vivre une forme qui était comme la figure idéale, immanente à leurs logis successifs, du salon des Verdurin".

Bonne et heureuse année 2009 !
"Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt". Albert Einstein
"Le 1er janvier 1945 à Hiroshima, les gens s'étaient souhaité une bonne et heureuse année". Philippe Geluck, bande déssinée Le Chat.
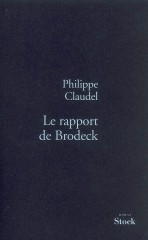
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien ». Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck.
Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Il y a des circonstances qui vous entraînent loin, trop loin sans doute et à votre insu. Comme une rivière tumultueuse qui vous charrie tel un rondin de bois, au début doucement. Avec tendresse même, vous laissant profiter du spectacle de ses berges verdoyantes, hérissées d’arbres bedonnants aux branches souples, assoiffées, ployant et touchant presque la surface de l’eau. Voyage tranquille vous permettant d’humer les senteurs provenant des rives du cours d’eau paisible : tapis bigarré d’Angéliques sauvages, Pas-d’âne, Soucis d’eau, Swerties vivaces ou grassettes communes, d’où exhalent des flagrances délicates.
Voilà un charmant voyage, vous vous dites. Mais arrivé à un méchant coude, le lit se resserre et la pente auparavant douce comme un chaton se métamorphose en redoutable tigresse. Vous ne vous promenez plus le long d’une calme et paisible rivière mais c’est un bouillonnant torrent qui vous emporte comme une vulgaire et anodine coquille de noix, ballottée, secouée dans les remous d’une rive à l’autre, entraînée par ce méchant courant. Les méandres se succèdent, les affluents aussi et on ne sait guère où le voyage va se terminer.
C’était ce voyage tumultueux semé d’embûches, inoffensif au début mais terrible ensuite qui m’avait entraîné si loin. Tout s’était enchaîné trop vite sans que je puisse reprendre mon souffle, sans que je puisse réfléchir à la portée de mes actes anodins en apparence.
Etait-ce une illusion ? Cette impression de n’y être pour rien. D’avoir laissé faire les choses comme un spectateur.
Je n’en sais toujours rien. Mais le fait est là : j’étais devenu un criminel. J’avais laissé mon voisin atteint de la maladie d’Alzheimer et gravement allergique manger des cacahouètes et je l’avais regardé suffoquant, sans lever le plus petit doigt. J’aurais pu saisir le combiné, composer les deux chiffres du SAMU…
Mais je n’avais rien fait.
Je ne l’avais pas tué : je l’avais laissé mourir. Etait-ce si différent ?
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Il était une fois, un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream». Le Vieil Homme et la Mer, Ernest Hemingway.
Il était une fois, un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Il avait tant ramené de poissons, tant promené sa silhouette pataude sur le pont et dans les embruns, tant navigué sur son vieux chalutier rouillé, que son cœur s’était gorgé d’eau, de sel et de solitude. Perdu au milieu des flots, loin de tout, des hommes, des terres, du bruit des mots, de la musique, des pas des hommes, il se plaisait : là, perdu dans l’immensité bleue, était sa place.
Pendant presque un demi-siècle, son chalutier l’avait conduit à suivre les courants chauds et les bancs de poissons. Il y a longtemps, c’était un art, un exercice périlleux, une habile technique qui s’apprenait laborieusement et patiemment avec le temps : connaître la météorologie, les vents et les nuages, suivre le vol des oiseaux, examiner l’écume, goûter le sel de l’eau… Maintenant c’était plus triste. Il n’y avait plus que des points qui scintillaient sur l’écran vert de son sonar. Ça bougeait, ça se regroupait, ça ondoyait et lui suivait du mieux qu’il le pouvait avec les quelques tonnes de ferraille que son antique diesel tachait de pousser. La coque craquait, gémissait, criait sous l’effet du tangage et fréquemment quand les éléments se déchainaient, quand le ciel et l’eau n’étaient plus qu’un, que le vent sifflait à rendre fou et les vagues déferlaient, jetant leur écume baveuse partout et que le vieux bateau enfournait, ployant sous le paquet de mer, noyant sa proue dans la vague, le vieux marin espérait presque le naufrage.
Là, il avait vécu, vibré, sué, espéré, frémi et vieilli.
Là, il voulait mourir.
Il les distinguait ces bras d’eau, lugubres, froids, glaçants, qui l’entouraient, l’encerclaient, l’étouffaient pour l’entraîner lui et son rafiot, dans sa dernière demeure, dans ce qui sera son tombeau dans la froideur et l’obscurité des fonds marins où il espérait que quelques sirènes voudraient lui prendre la main pour le rassurer. Car il avait beau être marin, vaillant, brave et ardent, avoir le muscle sec et puissant, le regard vif et bleu, le front haut et un cœur d’irlandais, la grande faucheuse qui cogne à la porte de sa cabine le faisait frissonner. Son bateau disloqué, fléchissant sous les paquets d’eau de mer et plongeant dans l’abîme, il l’imaginait. Le fluide glacé inondait la cabine, montait inexorablement, et pénétrait en tout, comme un venin dans des veines. Sa bouche, ses fosses nasales, sa gorge, ses poumons cherchaient désespérément quelque bouffée d’air salvatrice. Mais rien. Rien que le silence, le froid, l’obscurité et des bulles qui s’échappent vers la surface qui s’éloigne à jamais.
Aujourd’hui la mer était calme comme un lac, pas une vague, pas une ride sur cette plate immensité. Et le vieux marin, un rictus au coin des lèvres sèches, ajustant son bonnet et portant son regard loin, très loin, là où les goélands se perdent dans les nuages, pensa que la faucheuse, toute de noire vêtue, pouvait toujours l’astiquer sa faux et la ranger au placard.
Aujourd’hui il allait pouvoir pêcher, sereinement.
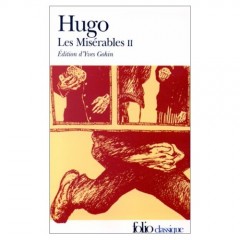 Les Misérables, Victor Hugo
Les Misérables, Victor Hugo
Quatrième partie, livre quinzième, La rue de l'homme-armé, Les excès de zèle de Gavroche :
"Pour la seconde fois, il s'arrêta net.
- Tiens, dit-il, c'est lui. Bonjour, l'ordre public.
Les étonnements de Gavroche étaient courts et dégelaient vite.
- Où vas-tu, voyou ? cria le sergent.
- Citoyen, dit Gavroche je ne vous ai pas encore appelé bourgeois. Pourquoi m'insultez-vous ?
- Où vas-tu, drôle ?
- Monsieur, reprit Gavroche, vous étiez peut-être hier un homme d'esprit, mais vous avez été destitué ce matin.
- Je te demande où tu vas, gredin ?
Gavroche répondit :
- Vous parlez gentiment. Vrai, on ne vous donnerait pas votre âge. Vous devriez vendre tous vos cheveux cent francs la pièce. Cela vous ferait cinq cent francs.
- Où vas-tu ? où vas-tu ? où vas-tu, bandit ?
Gavroche reprit :
- Voilà de vilains mots. La première fois qu'on vous donnera à téter , il faudra qu'on vous essuie mieux la bouche.
Le sergent croisa la bayonnette.
- Me diras-tu où tu vas, à la fin, misérable ?
- Mon général, dit Gavroche, je vas chercher le médecin pour mon épouse qui est en couches.
- Aux armes ! cria le sergent.
Se sauver par ce qui vous a perdu, c'est là le chef-d'oeuvre des hommes forts; Gavroche mesura d'un coup d'oeil toute la situation. C'était la charette qui l'avait compromis, c'était à la charette de le protéger.
Au moment où le sergent allait fondre sur Gavroche, la charette, devenue projectile et lancée à tour de bras, roulait sur lui avec furie, et le sergent, atteint en plein ventre, tombait à la renverse dans le ruisseau pendant que son fusil partait en l'air.
Au cri du sergent, les hommes du poste étaient sortis pêle-mêle; le coup de fusil détermina une décharge générale au hasard, après laquelle on rechargea les armes et l'on recommença.
Cette mousquetade à colin-maillard dura un bon quart d'heure, et tua quelques carreaux de vitre".

"Un écrivain américain à chaque ouvrage repart à zéro : le succès de l'oeuvre précédente ne lui garantit nullement que son éditeur ne refusera pas un nouveau manuscrit trop faible. Quiconque en france s'est trouvé une fois édité, si son début a été seulement honorable, a toutes chances de l'être toujours : il y compte d'ailleurs, et ne pourrait voir dans un refus qu'un affront ou une ténébreuse manoeuvre."
"Dans la conscience de chacun, le sentiment de quelque chose de dérisoire et même de coupable a fini par colorer insidieusement les réactions d'ailleurs de plus en plus apeurées du sens individuel, et même là où, comme en littérature le goût n'avait aucune raison de laisser prescrire son droit à trancher immédiatement, on dirait qu'une contamination s'est produite : à la réaction extrêmement prudente et cauteleuse, pleine d'inhibitions, qui est aujourd'hui celle du lecteur moyen quand on le sollicite de juger en l'abscence de tout repère critique, on sent que la caution des spécialistes auxquels il se réfère d'instinct en toutes matières, lui fait ici défaut cruellement, qu'il a le sentiment de s'avancer en terrain miné, de n'avoir pas en mains tous les éléments".
"Le grand public, par un entraînement inconscient, exige de nos jours comme une preuve cette transmutation bizarre du qualitatif en quantitatif, qui fait que l'écrivain aujourd'hui se doit de représenter, comme on dit, une surface, avant même parfois d'avoir un talent".
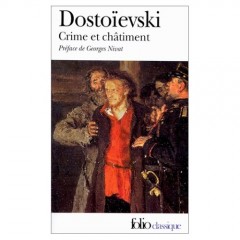 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la toute petite chambre qu’il louait dans la ruelle S… et se dirigea d’un pas indécis et lent vers le pont K ». Fédor Dostoïevski, Crime et châtiment
Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la toute petite chambre qu’il louait dans la ruelle S… et se dirigea d’un pas indécis et lent vers le pont K. Par bonheur, il ne croisa pas sa voisine de palier, Irina, qui était sortie quelques minutes avant lui. Il ne revit pas sa frêle silhouette, ses avant bras laiteux et ses doux cheveux blonds. Il ne croisa pas son regard, bleu comme un reflet du ciel sur la banquise. Il n’eut pas à sonder son cœur, à parler à ses yeux pour lui arracher les mots que ses lèvres ne consentaient à lui susurrer.
Elle l’aimait toujours et il l’aurait lu dans l’azur de ses yeux. Elle l’aimait et elle avait rompu. Elle avait rompu après une folle semaine où leurs cœurs s’étaient élancés, tels des chevaux prenant le mors aux dents, fougueusement, passionnément, dans une merveilleuse histoire d’amour.
Il était à présent arrivé sur le pont K. Le jour avait fini de décliner et de vieux lampadaires en fonte aspergeaient une lumière timide, blafarde, spectrale et fantomatique, découpant la silhouette du jeune homme grossièrement en une forme indécise et tremblante comme une flamme dans le vent. Le bruit de la ville parvenait faiblement à ses oreilles, et il ne vit pas une jeune femme s’approchait de lui, comme si tout son être n’était plus que ce corps se penchant au-dessus du parapet.
Se pencher un peu plus.
Un point au bout d’une ligne. Fermer ses yeux pour ne plus voir. Une lumière qu’on éteint le soir quand les volets sont tirés ; et l’obscurité qui gorge tout l’espace. Il voulait tout cela à la fois. Ou plutôt, il ne voulait plus rien, pas même continuer à vivre.
Il enjamba le parapet. L’air était doux. Les reflets des lumières ondoyaient devant lui. Les flots étaient maintenant sous ses pieds et il était prêt à se faire engloutir par le trouble de l’eau.
L’inconnue n’hésita plus, elle accéléra le pas, fonça sur lui et lui saisit le poignet, l’obligeant à revenir de l’autre côté. Du côté des vivants. Il croisa son regard, magnifié. Elle avait un beau sourire.
 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes ». Luis Sepulveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour
Le ciel était une panse d’âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Nous marchions en file indienne à découvert et à flanc de colline et à chaque pas, je redoutais un peu plus que les cieux gris, pesants et lourds, poisseux et humides nous avalent comme une vulgaire bouchée, proie trop facile dans le déchaînement des forces de la nature. Des éclairs zébraient à présent l’atmosphère charbonneuse et il n’y avait en vue, nul endroit pour nous abriter. Cela semblait tonner de partout, résonnait tout autour comme si nous avions été enfermés dans une grosse caisse qu’un mauvais génie aurait frappé sans relâche et avec force. Nous aurions pu marcher des heures, à perdre haleine, sans jamais trouver un arbre, un toit, quelque porche ou abri pour nous protéger de la pluie, des bourrasques et de la foudre, pour nous sécher un peu et nous reposer du déluge qui s’abattait sur nos têtes. Rien sur l’horizon. Lisse tel le crâne d’un chauve. Désespérant et inquiétant.
Nous finîmes par nous arrêter, épuisés, las, vidés et nous nous écroulâmes tous ensemble le nez dans la terre comme des quilles balayées méchamment, abandonnant tous dans cet épuisement contagieux. Ce que nous aurions dû décider par intelligence, nous en fûmes contraint par la force. La nature reprend toujours le dessus sur l’homme et nous passâmes la nuit, trempés jusqu’à l’os, tremblant, comateux, délirant de fièvre, le corps dans la boue mais à l’abri de la foudre.
Quand le jour parut, nous fûmes saisis par la clarté du ciel : tout avait été balayé. Pas un nuage, plus de traces du combat de la veille entre les cieux et la terre. Seul stigmate : de la boue sèche sur nos habits et nos corps, de la fièvre dans nos têtes et la peur au ventre d’être passé près de l’irréparable.
 "Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
"Le roman, c'est une drogue. C'est la liberté totale. Madame de Stael disait : " les romanciers sont plus à nu dans leurs oeuvres de fiction que dans leur autobiographie." Je pense que je parle plus de moi dans mes romans que Christine Angot dans ses autofictions. Comme disait Valère Novarina : "Ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'on ne peut pas dire." "
Anna Gavalda

"Les écrivains sont fragiles. Tous les êtres humains sont fragiles, mais les écrviains sont vraiment des petites choses très fragiles qui peuvent se casser facilement... Donc tout ce qui leur donne du soutien, qui leur remonte le moral, est très bon".
J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.
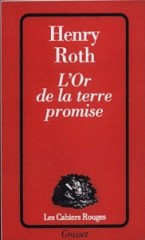 Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
« Debout devant l’évier de la cuisine, les yeux fixés sur les robinets de cuivre qui brillaient si loin de lui et sur la goutte d’eau pendue au bout de leur nez, qui grossissait lentement, puis tombait, David prit conscience une fois de plus que ce monde avait été crée sans tenir compte de lui». Henri Roth, L’Or de la terre promise
Debout devant l’évier de la cuisine, les yeux fixés sur les robinets de cuivre qui brillaient si loin de lui et sur la goutte d’eau pendue au bout de leur nez, qui grossissait lentement, puis tombait, David prit conscience une fois de plus que ce monde avait été crée sans tenir compte de lui. Il lui était impossible d’atteindre la poignée du robinet, de la tourner même légèrement pour faire couler un peu d’eau pour remplir son verre. Il allait devoir attendre le retour de ses parents, ce soir, quand la nuit aura enveloppé de ses bras inquiétants tout le quartier et que l’horloge dans la cuisine indiquera les vingt et une heures avec ses aiguilles suiffeuses et répugnantes. Il les suivait souvent du regard pendant des heures, espérant et craignant à la fois, le retour de son père ou de sa mère.
En attendant, il lui fallait étancher sa soif. Il aurait vendu une petite auto, s’il en avait eu une, comme celles qu’il regardait avec envie dans la vitrine du marchand de jouets quand il passait sur la 7ème avenue, pour s’acheter une bouteille de Coca Cola. Il ouvrit le réfrigérateur et envia la bouteille de lait. Son père s’en apercevrait certainement. Il allait être furieux puis violent mais à vrai dire, il le cognera bien ce soir pour un oui ou pour un non alors qu’est-ce que cela changera pour lui, une rouste, c’est une rouste.
Il hésitait, tournant nerveusement avec son index une petite boucle de cheveux mordorés près de ses oreilles. Il pouvait toujours sortir mais il n’avait pas d’argent. Il y avait bien le petit pot en grès où sa mère laissait toujours quelques pièces mais s’il venait à manquer rien qu’un seul penny, sa mère ne décolérerait pas de si tôt et son père lèverait la main sur lui. Non, et puis il avait trop peur de sortir seul ; il préférait encore rester à l’appartement et mourir de soif.
Il ferma le réfrigérateur puis le rouvrit aussitôt, empoigna la bouteille de lait et se versa un grand verre qu’il bu d’un trait avec délice. C’était fait. La bêtise était consommée. Il se resservit alors un second verre car autant qu’il le savait, l’intensité des raclées qu’il recevait n’était pas proportionnelle à la gravité de la sottise. David bu cette fois-ci plus lentement, appréciant la descente du liquide laiteux le long de sa gorge. La bouteille était maintenant à moitié vide.
Il rangea le tout et alla se lover dans l’espèce de long siège, élimé, défoncé, nauséabond, bringuebalant sous les fesses, poisseux sous les doigts et hideux pour le regard que ses parents désignaient sous le doux nom de canapé. La calme avant la tempête. La douceur de se pelotonner comme un petit chat avant la rudesse des coups. Il resta là de longues heures hébété de fatigue, de stupeur et par la froideur de l’appartement car le poêle qui servait à chauffer les lieux n’avait plus de combustible depuis trois jours.
Il était résigné de la vie, comme une mouche à qui on aurait ôté les ailes et qui tournerait sans fin sur une table engluée dans une tristesse et une lassitude infinie, dans un monde d’adultes tyranniques, odieux et sans cœur.
Son père rentra le soir, bien après sa mère, et se coucha sans avoir remarqué qu’il avait bu du lait dans la journée. Sa mère gueula qu’il était soul et qu’il avait bu la paye au bistrot. Sa mère se vautra aussi dans son lit et il fit de même.
Il pouvait à présent biffer sur le calendrier de sa misérable existence, une journée de plus.