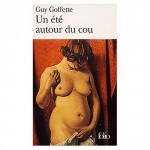 Les six premières phrases du roman de Guy Goffette : Un été autour du cou
Les six premières phrases du roman de Guy Goffette : Un été autour du cou
"1
La Monette avait tout, savait tout; moi, rien. Elle m'a pris sous son aile, m'a roulé dans ses draps puis dans la farine. Puis foulé aux pieds, puis jeté dehors. J'avais douze ans à peine; elle, trente de plus.
2
Si seulement ç'avait été des bonbons roses ou verts ou bleus, n'importe, des bonbons acidulés qui fondent lentement sous la langue avec un goût de jardin sauvage, d'iode, de revenez-y; si seulement elle me les avait offerts, caramels, dragées, pralines, que sais-je, comme une grande sœur, une marraine de communion, en me regardant droit dans les yeux, rieuse, complice un peu, et pas la bouche gourmande, les lèvres entrouvertes, gonflées, humides, brillantes comme sur l'affiche du cinéma Lux qui me faisait m'attarder longuement au retour de l'école ; si elle m'avait enveloppé en douceur dans sa voix de renarde, traînante comme la steppe, le temps que s'arrondissent au fond de ma gorge l'accent et le souffle, jusqu'à ce qu'ils me deviennent naturels et familiers comme un galet longtemps poli par la mer, le même que celui que je serrais dans ma poche en la regardant, chaud et moite et presque fondant tout à coup, au lieu d'en remettre comme elle avait fait sur la langueur et le rauque d'une sirène de lupanar; si elle m'avait aimé avec sa voix seulement, du bout des lèvres, susurrante et mouillée, câline comme un creux d'herbes moussues, de quoi rêver à l'amour et m'ouvrir lentement au mystère de la femme, au lieu de me jeter sa chair nue à la figure et de m'obliger à y boire, la tête maintenue dans le feu du torrent, moi qui ne connaissais que l'eau du robinet, j'aurais pu continuer de grandir à mon rythme de petit campagnard rêveur et délicat, marcher en sifflotant dans la rue comme le gamin que j'étais encore, sans honte aucune de mes bras maigres et de mes culottes courtes; j'aurais pu continuer de dire papa à mon père, et maman, et bonjour madame sans rougir, et donner des ordres à mes soldats de plomb sans que ma voix se mette soudain à douter d'elle-même, à trembler; et parler encore chaque soir après l'école à mon lapin comme à un petit frère dodu, caressant, et le nourrir avec la carotte dérobée au potager voisin ou avec l'herbe folle des talus; j'aurais pu oublier de me laver les dents de temps à autre ou de changer de chemise, de chaussettes; et jouer encore à qui pissera le plus haut contre le mur de l'église, fumer derrière la haie avec le fils du médecin les cigarettes blondes qu'il barbotait à son père et qui nous faisaient déchirer le ciel en toussant comme des malades; ou, dans le hangar abandonné, derrière les barils vides qui empestaient l'essence et la benzine, toucher la fente lisse et légèrement rougie sur les bords de la petite Pauline, la fille du voisin, une grassouillette aux yeux de poisson, et consentir finalement à lui montrer comme promis mon machin à moi qu'elle aimait serrer dans sa main jusqu'à ce que la chaleur me monte au ventre et que ça durcisse; j'aurais pu manger encore avec les doigts, graisseux, ongles en deuil, et cracher par terre comme Julos le marin depuis qu'il était revenu de l'Arctique, sourd et manchot, et passait son temps à taper la carte et à raconter aux gosses attroupés ses combats solitaires avec des cachalots gigantesques qui le poursuivaient; j'aurais pu me curer le nez derrière Zig et Puce en attendant que mon père me propose le tisonnier, tellement plus commode et efficace, n'est-ce pas? et finir tout de même par m'essuyer les doigts au bord des nappes et sur le dessous des chaises; j'aurais pu supporter de dormir encore dans la sueur et la morve de mon frère cadet quand il y avait en bas une soirée avec cartes, tricots, liqueurs, alcools et cent histoires salées qui faisaient s'esclaffer les hommes; supporter d'être exclu de la société des grands, et ronger mon frein, allongé contre le petit renifleur endormi, de ne pas pouvoir rire avec eux, même sans rien comprendre, simplement rire, contagieusement rire, solidaire enfin et définitivement homme; j'aurais pu voir encore et encore la mer au fond du jardin et toute la nuit l'entendre rouler à grand fracas ses eaux consolatrices derrière la rangée de peupliers où le vent larguait toutes les voiles, et puis partir, partir enfin, partir déjà, embarquer
avec Colomb, Vasco de Gama, le bras coupé de Julos, pour cette terre sans horizon où flottent les banquises et les bisons du Grand Manitou.
J'aurais pu, surtout, le cœur léger, marcher longtemps, longtemps avec une rose à la main vers une jeune fille aux jambes nues, tout partager avec elle et n'avoir plus de secret. "
Guy Goffette : Un été autour du cou

 "La 2 CV est une boîte cranienne de type primate : orifices oculaires du parebrise, nasal du radiateur, visière orbitaire des pare-solei, mâchoire prognathe du moteur, légère convexité pariétale du toit, rien n'y manque, pas même la protubérance cérébelleuse du coffre arrière."
"La 2 CV est une boîte cranienne de type primate : orifices oculaires du parebrise, nasal du radiateur, visière orbitaire des pare-solei, mâchoire prognathe du moteur, légère convexité pariétale du toit, rien n'y manque, pas même la protubérance cérébelleuse du coffre arrière." Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle. Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
Toujours le même principe : à partir de la première phrase d'un roman, écrire une nouvelle.
 "Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le coeur. Les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre, et que j'y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien.
"Je ne sais pas trop par où commencer. C'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le coeur. Les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre, et que j'y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien.